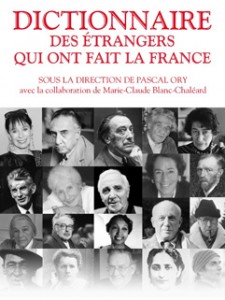Texte écrit à l’occasion d’une conférence collective consacrée à Jean Daniel, pour son 90ème anniversaire.
Intervention du 11 février 2011 à l’Institut du Monde Arabe, salle du Grand Conseil, à Paris
Jean Daniel a donné une fois de lui-même la définition la plus simple et la plus claire qui soit : « Je suis un Méditerranéen et un écrivain français ». Définition simple et claire en apparence seulement. Car quoi de plus complexe que la Méditerranée, quoi de moins clair que la mer des pérégrinations d’Ulysse, celle de tous les naufrages aux jours et mois de l’identité perdue et recherchée, cette Ithaque introuvable où l’on est peut-être encore attendu ? Comme il y a une Méditerranée bleue, il existe une Méditerranée noire et les hommes du XXe siècle, Jean Daniel parmi eux, et ceux d’aujourd’hui comme on le voit en Tunisie et en Égypte, ont eu droit (ont droit) jusqu’à plus soif à cette Méditerranée-là : tous les conflits dans tous les pays riverains, toutes les formes de violence et presque tous les conflits armés dont le plus exemplaire qui soit dans le mal, à savoir l’interminable conflit israélo-arabe devenu le conflit israélo-palestinien.
Jean Daniel, natif d’Algérie, et qui vécut comme une partie de lui-même et de sa conscience la terrible guerre d’Algérie : c’est ce terrain miné à mort et sur plusieurs niveaux qui fit de notre grand hôte d’aujourd’hui l’irremplaçable journaliste qu’il est très vite devenu. Témoin et témoin engagé, défricheur et déchiffreur d’événements, inimitable dans sa densité d’analyse et son sens de la formule. Et le Méditerranéen que donc il est et qu’il veut être, dans la définition qu’il donne de lui-même et que j’ai citée en coup d’archet initial à ce portrait, ajoute qu’il est aussi un « écrivain français ». Qu’est-ce qu’un écrivain français ?
C’est, quand on est Jean Daniel, une équation compliquée et complexe, aussi difficile à résoudre que la référence à l’identité méditerranéenne qui surplombe et retient en elle toutes les autres couches de l’identité constituée.
Être un écrivain français suppose, certes, l’intégration de soi à une nationalité reconnue, voire revendiquée si elle est l’objet d’une mise en cause ou d’une menace : Jean Daniel, cette conscience du socialisme à la française (ce mot de conscience, s’agissant de lui, ne peut que revenir souvent sous ma plume), du socialisme tout court quand c’est aussi d’humanisme qu’il s’agit, (c’est-à-dire quand l’effort politique et social d’une communauté nationale donnée fait que l’homme et la femme se sentent chez eux dans une société et se reconnaissent volontiers dans les valeurs de cette dite société), Jean Daniel, homme de liberté, et qui fit partie aux temps les plus noirs de l’histoire de l’Europe contemporaine de la légendaire Division Leclerc, n’a pas été gaulliste pour rien, gaullisme qui pourrait paraître de prime abord paradoxal s’agissant d’un ami très proche de Pierre Mendès-France, d’un disciple en quelque façon, – gaullisme pourtant auquel il n’a jamais failli.
“Écrivain français” selon ce qu’il s’estime être, il sait que quelque chose qui appartient au meilleur de la France, et qui fait que cet esprit tenté par quelque supranationalisme – qui saurait se situer en deçà de l’utopie – est dans sa langue, qu’il y a en quelque sorte un honneur de la langue et que cet honneur-là, qui est loin, bien loin, de tout académisme, consiste pour ceux qui en usent à servir cette langue, la française, Français fussent-ils ou francophones, avec rigueur, avec innovation, avec finesse, avec éclat. Récemment, il y a quelques mois, un éditorial de Jean Daniel, écrit à partir d’un colloque tenu à Casablanca, rendait hommage à l’installation décisive d’écrivains d’origine arabe en plein cœur de la langue française.
Ces écrivains, disait l’éditorialiste, ajoutent aux mots français l’apport précieux de leur identité la plus personnelle. Et c’est ainsi, par exemple, que j’ai eu une fois la joie de déjeuner à la table de Jean avec François Cheng le Chinois et Boualem Sansal l’Algérien. J’admirais en lui, tous trois nous admirions en lui, le journaliste impeccable et implacable, l’homme d’idées et d’intuition, l’analyste souvent prophétique, le moraliste jamais pris en défaut, l’homme curieux de tout et qui souvent écrit son éditorial d’une manière éclatée, en paragraphes séparés par des astérisques, pour éclairer tel ou tel aspect d’une actualité – politique, littéraire, scientifique, etc. – ouverte sur le mystérieux avenir. Mais ce qui nous éblouissait le plus, nous, lecteurs, dans les écrits d’un journaliste connu dans le monde entier, c’était tout simplement son écriture. Écriture d’un écrivain, d’un grand écrivain, et qui restera. Les éditoriaux ? Les reportages ? Les interviews ?
Sans doute resteront-ils comme documents et reflets des problèmes d’une époque et des personnalités qui l’auront faite. Les écrits immémoriaux – récits intimes d’un réel vécu et rêvé, les carnets, les souvenirs d’enfance, la traversée de la souffrance et presque de la mort sur un lit d’hôpital, les notes de voyage, les réveils dans les chambres de l’amour, les portraits de contemporains éminents ou fortement significatifs, les rencontres arrangées ou spontanées, les amitiés, les réflexions sur les hommes ou les livres, les méditations, – oui, c’est là l’œuvre qu’on lit avec passion, et avec laquelle de longs tête-à-tête s’imposent.
Il faut avoir lu Le Refuge et la source, Le Temps qui reste, La Blessure, Avec le temps, Les Miens, tous ouvrages parus chez Grasset, deux mille pages environ, pour se convaincre facilement de ce que j’avance. Deux mille pages qui racontent la courbe de vie d’un homme porteur en lui de plusieurs personnages contradictoires dont il tente, non sans diplomatie, de faire ou de refaire l’unité. Deux mille pages qui constituent un itinéraire accidenté, traversé d’ouragans historiques, de tourbillons intercontinentaux et aussi de mélodies intimes où chaque fois Jean Daniel est partie prenante, soit parce qu’il est l’un des agents postés sur le balcon de l’événement, soit parce qu’il est pris dedans. Très vite, dès 1970, il formule dans son journal personnel qui deviendra son livre Avec le temps[1] ce qu’il baptise « l’intensité de son itinéraire ».
À la date du 22 juillet, il note : « Je suis heureux de l’intensité de mon itinéraire jusque-là. Je n’en conçois aucune fierté particulière. Car je me suis senti toujours déterminé ou programmé. Je ne pouvais rien faire que ce que j’ai fait. Ensuite j’ai eu l’impression de chevaucher des hasards avec l’idée que j’avais plus avantage à suivre un destin qu’à exercer une liberté. Mais comme je veux conjurer le sort et regarder en face ce qui m’attend, je dresse le plus sévère état de mes lieux ».
Et plus loin : « […] Ayant toujours assumé mon rôle en termes de responsabilité plutôt qu’en termes de pouvoir, je ne pouvais m’accorder à moi-même l’importance dont me dotaient, pour en souligner l’injustice, les envieux, écrivains-journalistes ou universitaires qui s’indignaient tantôt que je prétendisse à diriger, tantôt que je fusse à la tête d’un véritable “club”. Je n’ai rien compris à leur procès parce que j’étais dans le tourment et le doute bien plus que dans l’autorité et l’arbitraire ».
Il y a là, me semble-t-il, exprimée à propos notamment de sa longue querelle avec les communistes, une prise de position qui définit chez lui une attitude constante face aux problèmes du monde : comme Montaigne, l’un de ses maîtres proclamés, il y a chez cet homme de conviction plus d’interrogations et de questionnements que de réponses catégoriques.
Jean Daniel, ami des grands penseurs de son temps – Camus, bien sûr, Foucault, Edgar Morin, Raymond Aron et Sartre, Berque et d’autres, tant d’autres… – a compris très vite, à voir leurs sévères contradictions, la nécessité du relativisme, cette plus haute leçon de l’histoire, surtout quand elle s’adresse à un homme que les idéaux et les principes ne laissent pas indifférents.
Le secret de cette force, chez Jean Daniel, de cet équilibre dans la force ? C’est, sans doute, l’amour. L’amour de la vie, absolu amour de ce Méditerranéen né dans la violence bleue de l’espace azuréen, et lui-même entouré par l’amour des siens, père, mère, frères, sœurs, comme dans les contes archétypaux de l’enfance et qui apprendra très vite dans un pays, l’Algérie, en train de basculer dans un grand vertige, que la vie est le plus grand des biens et que ce bien, de toute façon, a un prix, un prix à la mesure de ce qu’elle est. Il écrit, sur un lit d’hôpital, d’une écriture étrangement mystique chez un non-croyant éclairé cependant par un sens aigu du sacré : « Qu’est-ce qu’une vie que l’on n’est pas prêt à donner à chaque instant ? »
Ainsi a-t-il été aimé par les siens, ceux qu’il revendique comme tels, ainsi aimera-t-il les femmes de lui aimées, aimera-t-il les paysages et leurs pays, les œuvres d’art et leurs villes, la mer et ses vagues, – mer d’Homère, mer de Cézanne, mer de Paul Valéry, mer de Camus, Méditerranée, la sienne mer ?
Il s’y est plongé chaque fois qu’elle l’appelait, qu’elle l’attirait à elle, sirène primordiale, et que, restauré par son sel et son iode, il était de nouveau un peu plus lui-même pour mener – le délice quitté – ses durs, ses subtils combats. Je dis subtils parce qu’à toute autre forme d’argumentation, le grand journaliste pétri par les amitiés lumineuses et veilleuses qui l’ont formé, ayant ajouté à son propre pouvoir d’empathie ou à son instructive (quoique raisonnée) capacité de refus la considérable moisson d’idées recueillies dans les livres qu’il a lus, qu’il lit, avec qui il discute et débat, que le grand journaliste, dis-je, a choisi de se jeter dans la bataille non pas bardé d’idéologie et de thèses, mais de sa seule volonté, d’ailleurs têtue, de persuasion.
Persuader l’ami hésitant ou l’adversaire obtus avec l’arsenal d’idées jamais désincarnées, mais habillées de cette belle phrase courte et nerveuse qui est la sienne, parfois frappée en formule, voici le grand art. Jean Daniel – de “L’Express” au “Nouvel Obs” en passant par “Le Monde” (le journal alors de Beuve-Méry) – restera dans l’histoire du journalisme français (et sans doute du journalisme européen) comme l’un des plus brillants artistes de la plume. Cet art fera de lui l’un des plus avisés et des plus forts polémistes qui soient chaque fois qu’il le faut (et Dieu sait qu’il l’a fallu !), champion plein de sève et l’épée à la main de causes dures et douloureuses, souvent même terriblement dangereuses. A-t-on le droit de se citer soi-même ?
Jean Daniel éditorialiste m’a souvent ramené à cette règle de conduite que je m’étais, diplomate, fixée à moi-même : « Il faut sauver dans son ennemi son adversaire et, dans son adversaire, l’interlocuteur à venir. Il faut sauver dans son interlocuteur le moment du miroir ».
Très tôt, et presque dès le début de sa carrière, Jean Daniel se donne quelques règles sur lesquelles il ne reviendra jamais. Il rappelle et fait sienne la maxime de Platon : « Il faut aller à la vérité de toute son âme ». Plus loin, dans Le Temps qui reste, il déclare : « Si engagé que je fusse, j’avais besoin d’abord d’être témoin » et, dans le même livre, à propos du reportage dont il fut l’un des as, à des époques de violence (il en paiera fortement le prix à Bizerte) : « Le reportage fut pour moi l’occasion d’assouvir enfin, et spontanément, toutes ces velléités de “romancier du réel” que j’avais réprimées en renonçant à la littérature ».
« Romancier du réel », dit-il. Cependant de sa part, pourquoi ce renoncement à l’écriture purement littéraire ? L’échec relatif de son seul roman, L’Erreur, paru en 1953 chez Gallimard dans la prestigieuse collection “L’Espoir” de Camus n’explique rien ou pas assez. Lui qui a connu certains des plus grands, voire des plus illustres créateurs de son temps, qui les a interviewés parfois et dont certains ont même été ses collaborateurs, ayant été aussi ses amis, de Camus justement à Sartre, de Guilloux à Char, de Gide seulement entrevu à Mauriac et à Malraux, d’Umberto Eco à Milan Kundera, de Barthes à Foucault, de Claude Levi-Strauss à Soljenitsyne et à Gabriel Garcia Marquès, il croit tenir la réponse, imputant à sa préférence pour la vie immédiate à l’autre vie “patiente”, comme il la qualifie, ce feu qui lui fixe un mode d’interdit. Et dans les cinq ou six livres de lui que j’ai cités, il semble, tout en se racontant, faire lui-même sur ce point sa propre psychanalyse.
Jean Daniel, autour de ce sujet, rédige assez tôt dans le déroulement de sa vie une sorte de constat testimonial fait de positions simples et qui, je l’avoue, m’émeut : « Je me réclame de Jérusalem, de Fès et de Florence. Je crois à l’âge d’or de l’Andalousie, à l’époque des trois religions. Je pense surtout qu’il est passé des événements essentiels dans l’histoire des hommes. Lorsque Dieu a réclamé à Abraham de sacrifier un mouton plutôt que son fils : c’était si horrible de la part d’Abraham d’accepter l’idée de sacrifier son fils, mais ce fut une date historique que d’en finir avec les sacrifices humains jusque-là en usage.
Lorsque Jésus a empêché la lapidation de la femme adultère en déclarant : “Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre !”, il n’a pas seulement irradié la tolérance et la clémence : il a fondé le droit, en abolissant les procédés de la justice populaire. Lorsqu’en 1679, la révolution anglaise a décrété l’habeus corpus et promulgué les premières protections de l’individu à l’égard de l’État.
Lorsqu’enfin, les Américains, puis les Français, ont posé toutes les bases de l’État de droit, décidant ainsi pour le monde et pour les temps à venir ce que pouvait être la fameuse universalité des valeurs.
À tous ces moments, si on les relie entre elles, sont apparues les lumières. Ce ne sont pas celles de la science ni des théologies. Mais elles continuent de briller dans le cœur de chaque homme qui voudrait bien n’avoir d’autre malheur que celui d’être mortel »[2]. Humanisme européocentriste, diront certaines moralistes du Tiers-Monde. Le seul en tout cas jusqu’ici qui ait, bien ou mal, fait ses preuves.
*
C’est avec cette complexion faite de toute cette culture, de cette sensibilité toujours à vif que ce soit devant la nature et ses miraculeuses inspirations, que ce soit devant les œuvres d’art (l’architecture en particulier) et ses stupéfiantes incarnations qu’on aurait dites improbables que Jean Daniel, avec son délicat balancier intellectuel et cette sensibilité qu’il définit lui-même d’esthétique, aborde les vastes nuages qui dévastent – qui nécessairement dévastent – l’horizon politique, les nombreux horizons politiques de la planète et les barrent d’éclairs et d’orages plus ou moins attendus mais souvent imprévisibles jusqu’à l’heure toujours fragile et tout compte fait tissée de mille énigmes qui se donne parfois pour un temps d’éclaircie.
Il n’est personne, je l’ai dit, qu’il n’ait rencontré parmi les principaux décideurs, ceux dont on dit qu’ils “font l’histoire”, de Kennedy à Castro, de Mitterrand (qui finira par lui devenir l’objet d’un culte de pure admiration politique et, aussi bien, culturelle) à, disons, Sadate, martyr d’une volonté de paix que Jean Daniel a toujours placée au-dessus et au-delà de tout, de Deng le Chinois à Bourguiba, le président d’un pays particulièrement cher au cœur de l’amoureux des paysages et des maisons où se distille le rêve, à Nasser, à Senghor, à Hassan II.
Et pourtant, face à ces “grands” jamais assez repus d’eux-mêmes, et dont Jean Daniel trace souvent des portraits à l’acide que n’aurait pas reniés Saint-Simon, le journaliste ne s’est jamais départi de son exigence de liberté, de “liberté libre” comme dit Rimbaud. Il le dit dans une circonstance qui n’a rien à voir puisqu’il s’agit de sa rencontre avec Soljenitsyne, représentant d’une autre dimension de la grandeur, devant lequel il ne s’est pas assez effacé durant l’entretien télévisé ainsi que le lui reproche Raymond Aron : « La dévotion me fait horreur. J’aime, j’admire, je ne supporte pas de me courber. Je ne l’ai pas fait, je crois, devant aucun de ceux que j’ai le plus admirés dans ma vie. Personne. »
Ces hommes qui font l’histoire – et dont le “Nouvel Obs” chaque semaine nous décrit le comportement et analyse les positions – croient-ils vraiment à l’histoire et ont-ils encore l’intelligence de celle-ci ? D’ailleurs l’histoire a-t-elle désormais un sens, autrement dit une direction ?
Jean Daniel, à l’instar de beaucoup d’historiens de pointe, ne le croit pas. Il écrit, dans la préface de son livre Le Temps qui reste « Ce concept si passionnément discuté, le sens de l’histoire, nous l’avions sans doute déjà abandonné comme instrument de précision, philosophie des valeurs ou projet politique. Mais comme logique du déchiffrement du passé, et de descriptions des cycles et des courants, comme justification aussi, ce qui est plus grave, de certaines violences, nous le gardions à notre portée et nous avons fondé sur ses bases bien des échafaudages théoriques ».
Dans la même préface, il arrive à notre philosophe circonstanciel de resserrer, et pour un impact plus grand, l’angle de sa réflexion : « Ce ne sont pas les idéologies qui sont mortes, c’est leur prétention à annoncer le royaume des fins dernières qui a disparu. Il n’y a plus de paradis, ni au ciel, ni sur terre. Il n’y a plus que le présent. Un mot qui ne veut rien dire comme chacun sait : amputé de projets, le présent n’a que le visage du souvenir et de la menace ».
Dernière observation puisée dans le texte et qui éclaire, sous la plume de l’auteur, les circonstances de l’engagement irrésistible de Jean Daniel dans son corps-à-corps avec les problèmes de la planète, engagement sans retour : « La situation en 1953, écrit-il dans la préface si riche que j’ai déjà citée, ne paraissait grosse d’aucune promesse, lorsque l’aggravation douteuse de la guerre d’Indochine et l’éclatement de la crise marocaine ouvrirent le combat anticolonialiste. Combat précis, urgent, concret : il me concernait.
On se mit, au moins dans quelques milieux, à prendre la mesure d’un problème qui, pendant les années suivantes, devait dominer le monde – et d’abord la France. C’était ce que j’attendais. J’avais besoin de l’épaisseur de l’événement pour réagir d’abord en romancier (encore ce mot), en traduire la saveur, les contours, la chair. Je souhaitais aussi qu’il réclamât un engagement dans lequel l’accord avec soi-même fût enfin total – comme pendant la guerre contre le nazisme ».
*
Nous sommes ici, chers amis, à l’Institut du Monde Arabe. Il aurait fallu avoir du temps pour raconter l’histoire trépidante de ce monde avec ses aventures, ses quelques réussites, ses rêves et ses cauchemars, ses combats, ses nombreux échecs. Il aurait fallu pour mieux faire, dans le cadre de cet hommage, évoquer le rapport spécifique et si intense que Jean Daniel, juif natif d’Algérie et répondant de son nom originel arabe au patronyme de Bensaïd, qui signifie le Fils de l’heureux ou du bienheureux, oui, il aurait fallu pour une analyse poussée de ce rapport, de ces rapports, beaucoup d’heures et la matière de plusieurs thèses.
Allons à l’essentiel : Jean Daniel qui a, protégés par le bonheur du cœur, plusieurs pays arabes (l’Algérie, la Tunisie et le Maroc) mais qui est fasciné par presque tous les autres où, également, de vastes événements se produisent qui ne peuvent qu’alerter son attention et, Méditerranée et monothéisme obligent, déclencher ses analyses, mettre en activité fiévreuse sa salle d’opérations mentales et cela en raison de l’impact majeur que ces événements peuvent avoir sur la région considérée ou même, au vu du conflit israélo-arabe, sur l’ensemble du monde.
Ce conflit en particulier le requiert, comme il le fait pour chacun de nous, conflit devenu, au fil des décennies et du rétrécissement de la cause palestinienne sous les coups de boutoir que lui assène Israël d’une part et, d’autre part, par le lent mais continu désengagement de l’Europe (dont la France) et, plus hypocritement encore, les États-Unis, ce conflit est devenu le conflit israélo-palestinien : j’y reviendrai dans un instant.
Si j’ai évoqué à un moment donné de mon intervention le monothéisme abrahamique et la trilogie qu’il constitue, c’est que Jean Daniel est – il l’écrit : « un juif de solidarité et non de vocation » – obsédé cependant par les puissants mythes qui gouvernent l’imaginaire de l’humanité dont les trois abrahamismes : « la curiosité passionnée que j’ai des religions, note-t-il, m’a toujours détourné d’une choisir une ».
C’est sur fond religieux entre les musulmans natifs et les Européens chrétiens qu’il finit par conclure à l’impossibilité d’une paix de compromis en Algérie. Résumons l’affaire telle qu’elle se présente désormais : les Arabes et les musulmans en général ne sont pas aimés, et déjà sous Mitterrand, par personne, par presque personne : ni en France ni dans le reste de l’Europe. Jean Daniel lui-même, ébloui pourtant par l’audace du voyage effectué par Sadate à Jérusalem, parfois semble s’interroger.
Et il est vrai que les Arabes du XXe siècle et de ce siècle posent à la conscience des intellectuels arabes eux-mêmes, à travers certains de leurs dirigeants, un grand nombre de questions. Les juifs, d’ailleurs, ont aussi leurs problèmes et les Israéliens notamment et, par ces problèmes qui ne manquent pas, chaque jour c’est la conscience du monde entier qui est interrogée dans sa lucidité, et bloquée.
La plume de Jean Daniel traque les uns et les autres, Arabes et Israéliens, et, d’un éditorial l’autre, elle essaie de capter comme “un bel éclair qui durerait”, selon le vers d’Apollinaire, la moindre étincelle d’espérance. Le journaliste va jusqu’à écrire à propos des Israéliens, mais aussi à l’intention des juifs de France, ceci, – propos qui ne peut que le discréditer aux yeux des “siens” au sens le plus large et le moins adapté du mot :
« La Shoah n’autorise plus personne à s’abriter derrière la mémoire pour se conduire autrement que les autres : c’est ce que nous rappellent sans cesse, les grands, les admirables témoignages des survivants, de Primo Levi à Vassili Grossman. La puissance de l’entité israélo-américaine, au moment où les États-Unis en ont le monopole, protège sans doute les juifs d’un nouveau génocide mais leur donne en même temps une mission morale mille fois plus impérative. Eux plus que les autres, et s’ils tiennent encore à être des élus, ont l’obligation absolue d’être des “témoins et des prêtres” en souvenir de leur passé de souffrance »[3].
Nous voici en 2011 et rien, ni la guerre, ni la pression des États ou celle des Nations-Unies, ni la sagesse de Jean Daniel et de quelques autres dans le monde n’ont réussi à faire avancer d’un pouce la cause de la paix. Celle-ci recule avec la puissance d’un tsunami qui recule : à mon âge, quand à chaque heure le temps qui reste s’étrécit, on sent physiquement le sable se retirer brutalement sous ses pas.
Peut-être l’ultime position du témoin intègre et intégral qu’est l’homme dont nous parlons se trouve-t-elle exprimée dans l’un de ses derniers recueils de carnets où il s’essaie à décrypter le mystérieux geste de Jean-Paul II, “seul et courbé dans sa blanche soutane”, en train de glisser une lettre entre deux pierres du Mur des Lamentations à Jérusalem, al-Qods : « … Si je trouve un surplus de symboles à ce geste, écrit Jean Daniel dans Soleils d’hiver, c’est qu’il a lieu dans une terre habitée aussi et surtout par des musulmans, aussi et même surtout par des Palestiniens. Pourquoi ?
Parce qu’il était essentiel que le pape fût à même de démontrer que l’on pouvait partager la souffrance des Palestiniens et, dans le même élan, se repentir de ce que l’on avait laissé faire lors de la Shoah. Parce qu’il était, et qu’il est toujours d’une importance décisive d’établir que la réparation d’un calvaire ne saurait en justifier un autre.
Les Arabes, d’autre part, pour innocents qu’ils soient – et Dieu sait qu’ils le sont – des persécutions infligées aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, doivent tout de même comprendre pourquoi le monde est si souvent solidaire du destin du peuple hébreu. “Si un Palestinien ne fait pas un effort pour comprendre la Shoah, comment un Israélien pourrait-il comprendre le martyre du peuple palestinien ?” Qui a dit cela ? Le poète et essayiste palestinien Edward Saïd ».
Fin de citation.
Jean Daniel pourrait poser la question – comme tel héros royal semi-légendaire de cette terre martyrisée d’Iraq, Gilgamesh s’adressant au ciel au bout de ses longues et difficiles pérégrinations :
« Je suis venu sur cette terre pour changer quelque chose, mais si vraiment cela n’est pas possible, pourquoi, mon Dieu, m’en avez-vous insufflé le désir inquiet ? » Trois millénaires après, chacun attend toujours la réponse.
Salah Stétié
——————————————————————————–
[1] Avec le temps, carnets 1970-1998, Grasset, 1998.
[2] Préface de l’ouvrage : Le Temps qui reste, nouvelle édition revue et corrigée, 1983.
[3] Jean Daniel : Soleils d’hiver, carnets 1998-2000, Grasset, 2000.