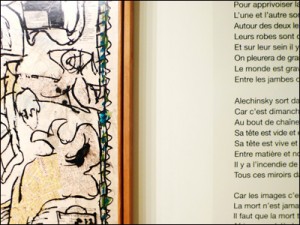Discours prononcé par Samaha Khoury, Professeur à l’université Bordeaux 3, Directeur de l’Institut d’Etudes Orientales (IDEO), à l’occasion de la remise du titre de Docteur honoris causa à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, le 11 décembre 2008
Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux, Chancelier des universités d’Aquitaine, Monsieur le Président et les Vice-présidents, Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
C’est un très grand honneur que m’a fait Monsieur le Président Singaravelou en me demandant de vous présenter ce soir Monsieur l’Ambassadeur Salah Stétié, poète de réputation internationale et grande figure de la francophonie mondiale.
Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas le mieux placé pour accomplir cette tâche redoutable et je crains, par manque de compétence en matière poétique, de ne pas rendre suffisamment justice à l’œuvre de notre invité.
Dans sa bienveillance, notre Président savait toutefois que je serai à l’aise sur certains chemins de Salah Stétié, notamment ceux qui ont fait de lui un grand penseur universel, un excellent médiateur entre les différentes cultures et civilisations, portant en lui le meilleur de l’Orient et le meilleur de l’Occident.
Avant d’aborder cette vision humaniste de Salah Stétié, je voudrais tout d’abord tracer en résumé son magnifique itinéraire :
Salah Stétié est né à Beyrouth le 25 décembre 1929, dans une vieille famille de la bourgeoisie sunnite. Son père, Mahmoud Stétié, enseignant, veille à ce qu’il apprenne le français dès son enfance, au Collège protestant français de Beyrouth, puis auprès des Jésuites, au Collège Saint-Joseph de l’Université de Beyrouth. Parallèlement, ce père, poète en langue arabe, lui transmet une solide culture arabo-musulmane. À partir de 1947, il effectue des études de lettres et de droit et suit également l’enseignement de Gabriel Bounoure qui est le premier de ses maîtres spirituels, à l’École Supérieure des Lettres de Beyrouth, où il rencontre notamment Georges Schehadé, son aîné d’un quart de siècle à qui il se lie d’amitié jusqu’à la mort du poète en 1988.
En 1951, une bourse française lui permet de s’inscrire à la Sorbonne. Il suit également les cours du grand orientaliste mystique Louis Massignon, le second de ses maîtres spirituels, à l’École Pratique des Hautes Études et au Collège de France. Il fait également partie de la première équipe des Lettres Nouvelles, importante revue créée à Paris en 1953 par Maurice Nadeau et Maurice Saillet.
Paris devient alors, à côté de Beyrouth, l’un de ses deux pôles intellectuels. Il y fait la connaissance de poètes et d’écrivains essentiels, comme Pierre Jean Jouve, Yves Bonnefoy, André du Bouchet, et d’autres, et s’intéresse à la nouvelle peinture française de l’époque. Cette passion ne cessera de s’intensifier au fil des années et donnera lieu à de nombreuses collaborations avec des peintres majeurs comme Zao Wou-Ki, Pierre Alechinsky et Antoni Tàpies.
Profondément attaché au Liban de son enfance qui demeure le lieu essentiel de son imaginaire poétique, il retourne à Beyrouth en 1955 et enseigne à l’École Supérieure de Lettres de Beyrouth et à l’Université Libanaise. Il fonde alors L’Orient Littéraire, supplément hebdomadaire du grand quotidien politique de langue française L’Orient, qu’il dirige jusqu’en 1961. En 1962 il entre dans la carrière diplomatique et occupe successivement divers postes : Conseiller culturel du Liban à Paris, puis Délégué permanent du Liban à l’UNESCO. À ce dernier titre, il joue un rôle majeur dans la mise au point et la réalisation du plan mondial de sauvegarde des monuments de Nubie lors de la construction du barrage d’Assouan. Puis il est élu Président du Comité Intergouvernemental de l’UNESCO pour le retour des biens culturels à leur pays d’origine en cas d’appropriation illégale ou de trafic illicite, poste qu’il occupera pendant sept ans. En 1982, il devient Ambassadeur du Liban aux Pays-Bas jusqu’en 1984, puis Ambassadeur au Maroc, de 1984 à 1987. En 1987, il est nommé Secrétaire général du ministère des Affaires Étrangères à Beyrouth, en pleine guerre civile, puis devient à nouveau à sa demande Ambassadeur du Liban à La HAYE, de 1991 à 1992. Parallèlement, il publie une œuvre d’une grande ampleur : plus d’une douzaine de recueils depuis L’Eau froide gardée, et, au fils des années, de nombreux essais en prose. Fin 1992, il prend sa retraite et s’installe dans les Yvelines. Tout en continuant à publier, il voyage beaucoup dans le monde entier en tant que conférencier invité ou comme participant à des colloques internationaux.
Salah Stétié a obtenu en 1972 le Prix de l’Amitié franco-arabe pour Les Porteurs de feu ; en 1980, le Prix Max-Jacob pour Inversion de l’arbre et du silence ; en 1995 le Grand Prix de la francophonie décerné par l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre ; en 2006, la Clé d’Or de la ville de Smederevo, le plus ancien Prix européen de poésie, pour l’ensemble de son œuvre poétique ; en 2007 le Grand Prix international de poésie des Biennales internationales de Liège.
Voici un extrait de ce qu’à son sujet écrit l’Encyclopedia Universalis « STÉTIÉ Salah : né au Liban, au carrefour des civilisations arabe et européenne. Salah Stétié a, plus qu’un autre, éprouvé le choc de l’histoire, vécu et souffert le désir d’unité. Cette confrontation, cependant, ne l’a pas conduit à choisir un monde contre un autre, mais bien au contraire à tenter de les concilier en forgeant un langage qui leur soit commun. Dans ce désir de voir dans le bassin méditerranéen un espace non de guerre mais de rencontre, il s’en explique dans son essai les Porteurs de feu (1972), à la fois prélude à sa poésie et étude approfondie des racines spirituelles du monde arabe ainsi que de son possible avenir ».
En outre, en préface à Fièvre et guérison de l’icône, paru en 1996 dans la prestigieuse collection de l’UNESCO « Œuvres représentatives », Yves Bonnefoy écrit dans sa longue préface présentant son ami : « C’est dans la poésie de Salah Stétié comme si le texte en était une vaste draperie ouverte d’images peintes … La surface de la pensée en est remuée, nous sommes appelés à entrer dans l’inconnaissance – un mot que Stétié emploie quelquefois et qui ne signifie nullement que nous soyons voués sur ces voies à ne rien connaître. Car, c’est vrai, cette poésie ne décrit pas un lieu, n’écrit pas une vie, au moins de façon explicitable, n’évoque pas des événements ; ce poète ne semble se souvenir dans son poème d’aucun de ces moments de la conscience ordinaire. Mais les mots qui nous sont rendus par lui si ouverts nous aident à nous écrire nous-mêmes, ils sont notre lisibilité soudain possible de par l’intérieur de nos actes. Ils aident à transfigurer en présences, en participations à la présence du monde, nos objets, nos savoirs les plus quotidiens ».
Un des thèmes majeurs de l’œuvre d’essayiste de Stétié est sa réflexion, depuis un demi-siècle, sur le destin de la Méditerranée et les perspectives qu’elle continue d’ouvrir à l’humanisme du futur. Son dernier livre Culture et violence en Méditerranée, publié en avril dernier, insiste en une suite de brillantes analyses, sur le fait que la Méditerranée, qui a réussi à donner naissance, en miroir l’une de l’autre, à la philosophie grecque et à la philosophie arabo-musulmane, est également la mère des trois monothéismes abrahamiques. C’est elle qui, au fil des siècles, instaure ce long dialogue entre la pensée philosophique rationnelle et l’inspiration spirituelle et mystique, contrepoint déterminant qui continue de nous interpeller et de nous préoccuper, à la fois dans l’espace méditerranéen mais également dans le reste du monde. Ce qui n’évite pas à la Méditerranée d’être en même temps ce lac de violence où les événements et les hommes doivent sans cesse être « réajustés » pour éviter ou dépasser la catastrophe.
Pour Stétié, « c’est sur le métissage que se fonde la civilisation de demain ». Il cite Senghor qui, cinquante ans plus tôt, affirmait : « la civilisation à venir sera métissée ou ne sera pas ». Stétié transformera plus tard, pour un usage plus rigoureux, le mot métissage en tissage, vocable qui affirme plus clairement encore le fait que la trame et la lice ne sauraient exister l’une sans l’autre.
Aujourd’hui, dans un monde désorienté et où l’idée d’une culture de convergence à vocation universelle s’éclipse devant une idéologie belliqueuse, qui préconise que les conflits du troisième millénaire seront provoqués par deux forces antagonistes, dont chacune est au service d’un objectif prétendument spirituel et qui partage le monde en entités imperméables les unes aux autres, seuls des penseurs de la stature de Salah Stétié peuvent aider à sauvegarder notre planète de l’obscurantisme et des guerres faussement saintes, théorisées par des prophètes du désastre comme le trop fameux Samuel Huntington,
Pour terminer, je m’adresse à mon très cher ami Salah Stétié pour saluer son immense talent, son humanisme et la pertinence de ses analyses et de son regard sur le monde d’aujourd’hui. Des telles qualités sont étayées chez lui par une connaissance approfondie des cultures et des religions, ce qui lui permet de passer outre le mauvais dépaysement, le racisme et les identités meurtrières, et de le faire dans une langue française d’une pureté incomparable, langue dont il écrit : « Ma relation à la langue française est une relation charnelle, passionnelle : exactement comme celle qu’on peut avoir avec une femme, une femme aimée au-delà de toutes les autres, mais qui cependant ne saurait me faire oublier où se trouvent mes racines et ce que représentent pour moi ma dimension libanaise et arabe ». Et il ajoute, citant l’écrivain portugais Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ».
Merci donc à Salah Stétié pour ce qu’il est : Un homme capable d’amour lucide, soumettant tout objet intellectuel et tout comportement humain à une analyse sans concession pour chercher dans la vérité des êtres et des choses le lieu de leur rapprochement essentiel et la possibilité de leur convergence par le haut.
C’est pour cela cher Salah Stétié, pour cette force en vous, que je suis convaincu que si le grand Montaigne, était encore en vie, il vous proposerait au jury du Prix Nobel. En ce jour, première étape, l’université qui porte son nom a l’immense honneur de vous décerner le titre de Docteur Honoris Causa.
Réponse, discours de Salah Stétié
SOUVENIR (Andeken)
Le Nord-Est souffle, de tous les vents mon préféré, car l’âme vive et bonne traversée il promet aux marins. Va, maintenant et salue la belle Garonne, et les jardins de Bordeaux là-bas, où sur la berge escarpée s’allonge le sentier, et dans la rivière vient choir de haut le torrent, tandis qu’au dessus guette un noble couple, peuplier et chêne.
Je m’en souviens bien, et comment le bois d’ormes abrite de ses hautes frondaisons le moulin, avec un figuier qui pousse dans la cour. Aux jours de fête se promènent En ce lieu les femmes brunes sur un sol soyeux, au mois de Mars, lorsque nuit et jour sont égaux, et par de lents chemins voyagent, alourdis de rêves d’or, les brises apaisantes.
Que quelqu’un maintenant me passe la coupe odorante remplie de sombre lumière afin que je me repose ; il serait doux de sommeiller dans l’ombre. Il n’est pas bon De s’avilir avec des pensées mortelles. Mais un entretien est chose bonne, et le dire des mots du cœur, et d’entendre parler des jours de l’amour, et des hauts faits, qui ont eu lieu.
Mais où sont les amis ? Bellarmin et ses compagnons ? Les hommes montrent leur peur, quand ils sont près de la source, l’origine de la richesse c’est la mer. Eux, tels des peintres assemblent la beauté de la terre, et ne dédaignent point la guerre ailée, ni d’habiter seuls de longues années, sous le mât sans feuilles, là où les jours de fête des villes ne brillent à travers la nuit, ni les instrument à cordes, ni les danses du pays.
Mais maintenant ces hommes s’en sont allés aux Indes, depuis le sommet ouvert aux vents, parmi des coteaux recouverts de vignes, jusqu’où descend la Dordogne et unie à la Garonne rutilante, larges comme une mer, s’en vont les eaux. Mais la mer donne et retire la mémoire, Et l’amour aussi cherche avec ferveur notre regard, Mais ce qui dure, les poètes le fournissent.
Traduction Patrick Hutchinson
Vous avez tous reconnu le poème de Holderlin chantant Bordeaux, cette magnifique ville où nous nous trouvons, nous aussi prisonniers de l’émerveillement poétique.
Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux, Chancelier des Universités d’Aquitaine, cher William Marois, Monsieur le Président de l’Université Bordeaux 3, cher ami Singaravelou, Monsieur le Professeur Samaha Khoury, Directeur du Centre d’Études et de Recherches sur le monde arabe et musulman, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mes chers amis,
C’est pour moi une grande émotion d’être ici, parmi vous, et de recevoir solennellement la dignité de Docteur Honoris Causa de la prestigieuse Université de Bordeaux 3. Celle qui porte le nom d’un des écrivains les plus déterminants, les plus lucides et les plus incisifs dans l’histoire du développement de la conscience humaine, Michel de Montaigne, à qui beaucoup d’hommes et de femmes dans le monde entier, de toutes nationalités et de toutes conditions, doivent, au sein même de leur culture, le sens de la nuance et celui de la relativité, le goût de l’ouverture à autrui, l’intuition fondamentale que ce qui forme l’homme c’est la pratique de l’humanisme mais que ce qui fonde l’humanisme c’est la pratique et le respect de l’homme. Voici peut-être l’une des plus grandes leçons de vie que m’a enseignée mon long métier de diplomate et très particulièrement de diplomate international puisque, sur les trente années de carrière diplomatique que j’ai assumées, une quinzaine de celles-ci ont été consacrées à l’Unesco, c’est-à-dire à l’organisation internationale qui prône activement le dialogue interculturel dans la pleine reconnaissance et le plein respect des identités nationales. Cette leçon de ma vie, la plus haute des leçons de ma vie, a été étayée, soutenue, inspirée, réinspirée sans cesse par la lecture des Essais, livre majeur auquel il faut toujours revenir chaque fois que le mauvais doute s’installe quant aux raisons d’être de l’homme et à ses raisons d’agir, à celles notamment parmi ces raisons qui conduisent au refus de l’autre, de ce qu’il est, de ce qu’il croit, qui conduisent en somme à ce qu’on appelle l’intolérance. C’est contre l’intolérance que s’est battu toute sa vie Montaigne ; c’est contre l’intolérance que s’est battu – si souvent ironiquement – un autre Bordelais, Montesquieu. Ce dernier écrit dans Les Lettres persanes : « J’avoue que les histoires sont remplies de guerres de religion. Mais qu’on y prenne bien garde : ce n’est point la multiplicité des religions qui a produit ces guerres, c’est l’esprit d’intolérance qui animait celle qui se croyait la dominante ; [l’] esprit de prosélytisme … C’est, enfin, cet esprit de vertige, dont les progrès ne peuvent être regardés que comme une éclipse entière de la raison humaine ». Ces paroles sonnent aujourd’hui plus tragiquement que jamais, à l’heure où des credo insuffisamment pensés et imparfaitement vécus donnent naissance à tant de violence dans le monde et à la montée brutale des intégrismes et des exclusives. Montaigne, lui, combat tous les excès, de quelque nature qu’ils soient, par la modération à laquelle il consacre le chapitre XXX de ses Essais. Relisons le début de ces pages magnifiquement éclairantes : « Comme si nous avions l’attachement infect, nous corrompons par notre maniement les choses qui d’elles-mêmes sont belles et bonnes. Nous pouvons saisir la vertu de façon qu’elle en deviendra vicieuse : si nous l’embrassons d’un désir trop âpre et violent. Ceux qui disent qu’il n’y a jamais d’excès en la vertu, d’autant que ce n’est plus vertu si l’excès y est, se jouent des paroles :
Le sage mérite le nom d’insensé, le juste celui d’injuste, S’ils aspirent à la vertu au-delà de la mesure.
« C’est une subtile considération de la philosophie. On peut et trop aimer la vertu, et se porter excessivement en une action juste. À ce biais s’accommode la voix divine : « ne soyez pas plus sages qu’il ne faut, mais soyez sobrement sages“ ».
Cette sagesse de Montaigne est, dans sa nature profonde, universelle. Elle est grecque, elle est aussi tchan, elle est zen. Peut-être exprime-t-elle à sa façon la sagesse de toute une ville, ce Bordeaux, cette Burdigala, qui fut considérable déjà en tant que métropole d’une province de l’Empire romain et qui, aux premiers siècles du christianisme occidental donna le jour à un important poète chrétien, Ausone, en attendant seize siècles plus tard un grand romancier chrétien, prix Nobel de littérature, François Mauriac, que j’ai un peu connu dans le sillage de mon maître Louis Massignon, l’immense mystique que l’on sait. Cette sagesse de Bordeaux, et aussi ce sens de la poésie si profondément enraciné en elle et dans la beauté de son site et de ses monuments (« la plus belle ville de France », assurait Stendhal qui s’y connaissait), cette sagesse et cette poésie de Bordeaux, peut-être les doit-elle à son ouverture sur le vaste univers depuis la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb et ses successeurs immédiats. Pour le meilleur et parfois pour le pire, (je ne révèle rien), Bordeaux se mit très vite à l’heure du Nouveau Monde et, depuis, à l’heure tout simplement du monde, celui où nous vivons aujourd’hui, – en qui si merveilleusement et si dangereusement nous vivons. Le Bordeaux d’aujourd’hui continue de regarder vers le large, notamment vers le grand Ouest et le grand Sud atlantiques. Les Universités et les grandes Écoles de la ville, en particulier l’Université Michel de Montaigne, si ouverte sur le planisphère que son Président, mon cher ami le célèbre géographe qu’est M. Singaravelou vient de l’Inde et plus précisément de Pondichéry, oui, l’ensemble des prestigieuses institutions d’enseignement supérieur de Bordeaux accueillent, en toute francophonie, les étudiants venus d’Afrique du Nord, ceux venus d’Afrique noire, ceux d’Amérique Latine et d’ailleurs. Si nombreux sont ces étudiants et si nombreuses leurs langues que le Président Singaravelou s’apprête à ouvrir, s’il ne l’a déjà fait, un nouveau et vaste chantier pour promouvoir avec des moyens nouveaux et plus efficacement adaptés l’enseignement de bien des langues, admirables banques d’échanges immatériels riches de tout l’avenir de la planète.
Revenons, si vous le voulez bien, un peu à moi. « Le moi est haïssable, disait Paul Valéry, mais c’est celui des autres ». J’appartiens par mes racines, aussi loin que je distingue mes origines, au Liban, autre terre de culture, autre terre de sagesse et de mesure tant que ne vint pas à l’affoler le terrible conflit toujours irrésolu, toujours insoluble, du Proche-Orient, dont nous venons d’explorer tant d’aspects. Ce cancer du Proche-Orient est devenu à un moment donné le cancer propre du Liban, victime pendant quinze ans d’une atroce guerre civile, la plus incivile des guerres, armée et soutenue de l’extérieur par tous ceux qui avaient intérêt à ce que le Liban explosât. Mais le Liban n’a pas explosé, et il continue, n’est-ce pas mon cher compatriote, cher Docteur Samaha Khoury, à qui tant de liens fraternels me lient désormais ? « Le Liban, disait au XIXe siècle un voyageur français d’Orient, est un petit pays qui ne produit rien, sinon des Libanais ». Boutade, certes, mais qui témoigne d’une profonde vérité. Le Liban, la Phénicie antique qui a inventé, entre autres, la navigation directe (contre la pratique archaïque du cabotage) et qui a imaginé l’alphabet, deux moyens de relier plus rapidement les hommes, le Liban qui a donné le nom d’une de ses princesses, Europe, à tout un continent, est ce pays paradoxal qui abrite dix-neuf communautés religieuses, quatre langues et donc quatre cultures (l’arabe, le français, l’anglais et l’arménien), le Liban compte quatre millions et demi d’habitants à l’intérieur de ses frontières et près de seize millions d’émigrés dans le monde. Ce pays venu du fin fond de l’Histoire est magnifiquement implanté aujourd’hui dans la géographie planétaire. Il est partout, modestement, chez lui. Il est chez lui également dans la langue française, cette langue qui, à côté de l’arabe, est l’autre langue du pays, langue du cœur. « On est d’une langue comme on est d’un pays », disait Cioran, qui fut mon ami. Moi-même, comme écrivain, je suis parmi d’autres écrivains libanais de langue française, l’un des ressortissants de ce pays, la France, patrie mentale aussi précieuse à mon cœur que ma patrie physique.
Avant d’en terminer (sans doute ai-je été trop long, mais j’avais tant de choses à vous dire et, notamment, j’allais l’oublier, que le vignoble libanais est issu en droite ligne de l’illustre cépage bordelais par la grâce des Pères jésuites), je voudrais citer François Mauriac, sur le Liban précisément. En 1963, il écrivait en préface au livre de Jacques Nantet, Histoire du Liban, publié aux Éditions de Minuit : « Ce petit peuple (le peuple libanais) est né de la parole même de Dieu. Et dès lors tous les peuples, toutes les religions ont pu déferler sur cette terre consacrée : Égyptiens, Assyriens, Ottomans, et nous, Français, pour finir. Aucun d’eux n’a pu effacer cette empreinte, comme le pied d’un dieu qui demeure à jamais marqué dans la boue des vieux déluges, dans cette terre à jamais durcie. […] Il s’y est créé un équilibre entre tant de religions et de races que ce miracle étonne […]. Le Liban, lui, a réconcilié musulmans et chrétiens, et dans chacune de ses familles religieuses toutes les dissidences. Mais non, il ne s’agit pas de miracle, il n’existe pas de miracle en Histoire. Pourquoi celui-là fut-il possible et comment il s’est accompli, c’est tout le sujet du beau livre pour lequel Jacques Nantet m’a demandé cette préface ». Et Mauriac d’ajouter, à propos de ce qu’il considère, « par-delà toute politique », comme « l’union du Liban et de la France » : « Les écrivains libanais de langue française sont les témoins, et les garants de cette amitié – de cet amour ».
Oui, Monsieur le Président de l’Université Michel de Montaigne, oui, Mesdames et Messieurs les Membres du conseil de l’Université, oui, vous tous qui honorez cette séance solennelle de votre présence, je suis ce témoin et ce garant, porteur envers la France, de la part du Liban, d’un message de sympathie pluricentenaire. Dans l’émotion suscitée par ce message, il ne me reste qu’à vous remercier les uns et les autres, ce que je fais de tout cœur.
Lire aussi https://salahstetie.net/?p=704

 Salah Stétié est né à Beyrouth le 25 décembre 1929, à l’époque du protectorat français sur le Liban dans une vieille famille de la bourgeoisie sunnite. Son père, Mahmoud Stétié, enseignant, veille à ce qu’il apprenne le français dès son enfance, au Collège protestant français de Beyrouth, puis auprès des Jésuites, au Collège Saint-Joseph de l’Université de Beyrouth. Parallèlement, ce père, poète en langue arabe, lui transmet une solide culture arabo-musulmane. À partir de 1947, il effectue des études de lettres et de droit et suit également l’enseignement de Gabriel Boumoure qui est le premier de ses maîtres spirituels, à l’École Supérieure des Lettres de Beyrouth, où il rencontre notamment Georges Schehadé, son aîné d’un quart de siècle à qui il se lie d’amitié jusqu’à la mort du poète en 1988. En 1949, il devient professeur au célèbre Collège Méchitariste d’Alep.
Salah Stétié est né à Beyrouth le 25 décembre 1929, à l’époque du protectorat français sur le Liban dans une vieille famille de la bourgeoisie sunnite. Son père, Mahmoud Stétié, enseignant, veille à ce qu’il apprenne le français dès son enfance, au Collège protestant français de Beyrouth, puis auprès des Jésuites, au Collège Saint-Joseph de l’Université de Beyrouth. Parallèlement, ce père, poète en langue arabe, lui transmet une solide culture arabo-musulmane. À partir de 1947, il effectue des études de lettres et de droit et suit également l’enseignement de Gabriel Boumoure qui est le premier de ses maîtres spirituels, à l’École Supérieure des Lettres de Beyrouth, où il rencontre notamment Georges Schehadé, son aîné d’un quart de siècle à qui il se lie d’amitié jusqu’à la mort du poète en 1988. En 1949, il devient professeur au célèbre Collège Méchitariste d’Alep.