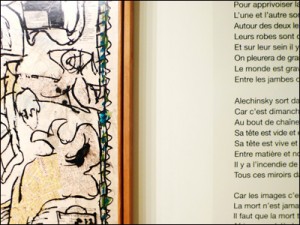Conférence donnée lors du Colloque international organisé à Rouen par Robert Kahn et Serge Linarès (Centre d’Etude et de Recherche Editer Interpréter, CEREdI, Université de Rouen) et par Christophe Martin (Centre des Sciences de la Littérature Française, CSLF) du 14 au 16 octobre 2010 : « Vers en images : l’iconographie de la poésie occidentale » (manuscrits enluminés, imprimés illustrés, livres de dialogue)
L’ORNEMENT, LIEU SPIRITUEL DE L’ISLAM
À ma connaissance, aucun des principaux spécialistes de l’art de l’Islam ne l’a jamais mentionnée, ni même y a fait allusion dans le cours de ses analyses : et pourtant, il y a dans le Coran une sourate intitulée « L’Ornement » (XLIII). Elle tire essentiellement son nom des ayât(s) ou versets suivants :
Nous aurions placé, dans leurs maisons, [les hommes] des portes, des lits de repos sur lesquels ils s’accorderaient et maint ornement.
Mais tout cela n’est que jouissance éphémère de la vie de ce monde La vie dernière, auprès de ton Seigneur, appartient à ceux qui le craignent[1] (34 – 35)
On le voit : l’ornement a droit de cité dans le Coran qui est la parole même d’Allah révélée à son serviteur Muhammad. De ce fait, il a, malgré sa nature apparemment secondaire, un statut éminemment ontologique qui fait de lui, en Islam, une entité à part entière. On sait que le Coran, comme Platon auparavant, prend position contre les poètes qui sont « suivis par ceux qui s’égarent ». Et pourtant le Coran autour duquel a longtemps tourné, et tourne toujours, la vie spirituelle, intellectuelle et artistique des communautés et des peuples de l’Islam, est, entre autres, qu’il le veuille ou non, un livre de très haute portée poétique, ne fût-ce déjà que par la forme et le recours au verset assonancé, avec, en plus de cette caractéristique interne, un décor de présentation esthétique qui, très souvent, dans l’abstraction de ses signes plastiques et l’élégance de sa calligraphie, atteint au chef-d’œuvre.
L’ornement est surface, le monde profondeur. Ce serait là sans doute banalité s’il n’était justement arrivé à l’ornement, par la médiation de l’Islam, de devenir la profondeur du monde; si la surface, autrement dit, n’était devenue l’éclat de la dimension spirituelle. Tel est le sens, dans tout ce qui suivra, de mon propos : il s’agira pour moi, on l’aura compris, de montrer la logique cachée de cet étonnant paradoxe. Et puisque paradoxe il y a, ce n’est pas seulement à la doctrine islamique que je me contenterai de demander une illustration de l’ornement – dans son rapport avec le monde, ainsi qu’avec le livre – mais je ferai également appel à un texte poétique célèbre du romantisme allemand –, convaincu que je suis de l’existence de nombreuses et puissantes convergences dans l’imaginaire humain.
On lit, en effet, dans les Disciples à Saïs de Novalis : « Peu après quelqu’un énonça : « L’Écriture Sainte n’a besoin d’aucune explication. Celui qui parle vrai, celui-là est plein de la vie éternelle et ses écrits nous paraissent être en prodigieuse affinité avec les authentiques mystères, car ils sont un accord de la symphonie de l’Univers. C’est assurément de notre maître que cette voix parlait, car il a l’intelligence de la synthèse et sait rassembler les traits qui sont pourtant épars. Un éclat particulier flamboie dans son regard lorsque, justement devant nous, les hautes runes se découvrent, et qu’alors il guette dans nos yeux et attend que se lève l’étoile, en nous aussi, qui doit nous rendre évidente et intelligible la Figure. »
Je reviendrai plus loin sur le rapport essentiel qui est celui, en Islam, de l’Étoile et de la Figure : autant du point de vue ontologique que du point de vue ornemental. Et, puisque se trouve évoquée la notion de figure, je dirai que la figure centrale de l’art islamique est, incontestablement, le polygone étoilé qui va accompagner de ses variations et de ses complications de plus en plus savamment élaborées, aussi bien en Orient qu’en Occident, tout le développement de cet art.
Mais revenons à Novalis : «Souvent il (le Maître) nous conta comment, lorsqu’il était enfant, son penchant à faire jouer ses sens, le soucis de s’occuper d’eux et de les satisfaire, ne lui laissaient aucun loisir. Il contemplait les étoiles et reproduisait sur le sable leur position et leur course. Sans repos il plongeait son regard dans l’océan des âmes, admirant sa transparence, ses mouvements, ses nuages, ses lumières ; et sa contemplation ne connaissait pas de fatigue. Il recueillait et assemblait des pierres, des fleurs, des scarabées de toutes sortes, les rangeait de diverses manières, en files, en séries. En lui il épiait le mouvement de ses pensées et de ses sentiments. Il ne savait pas où le poussait son immense désir.» Et pourtant si, dirai-je : il le sait. Novalis n’ajoute-t-il pas quelques lignes plus bas : « À présent il retrouve partout des choses connues – mêlées seulement et appariées étrangement – et ainsi, souvent, des choses s’ordonnaient d’elles-mêmes en lui, extraordinaires et rares. De bonne heure, en tout, il remarquait les combinaisons, les rencontres, les coïncidences. Il finit par ne voir plus rien isolément. Les perceptions de ses sens se pressaient en grandes images colorées et diverses : il entendait, voyait, touchait et pensait en même temps. Il se réjouissait à assembler les choses étrangères. Tantôt les étoiles étaient des hommes, tantôt les hommes des étoiles, les pierres des animaux, les nuages des plantes, […] il jouait avec les forces et les phénomènes ; il savait où et comment trouver ceci et cela, et il pouvait le laisser apparaître; et c’est ainsi qu’il touchait lui-même aux cordes profondes, cherchant sur elles et s’approchant des sons purs et des rythmes»[2]
Le point d’aboutissement de cette lecture de surface du monde par le Maître, c’est – par le long questionnement, par la lente incubation – l’apparition, sur cette même surface, iris de l’œil, tympan de l’ouïe, des « sons purs et des rythmes ». Plusieurs des opérations décrites par Novalis dans ce texte superbe et révélateur – au sens comme photographique du terme – me paraissent donner à l’ornement, au-delà de son statut épigraphique, sa dignité ontologique. Ne s’agit-il pas, d’abord, de s’investir totalement dans la longue contemplation du monde pour, en somme, s’en laisser pénétrer ? Puis, à partir de prises de détail(s) – une pierre, une fleur, un scarabée – d’imaginer les « files » et les « séries » en quoi et par quoi ces détails prendront figure d’ensemble, toute mise en forme d’une totalité exigeant immanquablement la disparition du détail en tant que tel, son abolition mallarméenne, son élévation à quelque rang plus pur de lui-même, son extraction suivie de son abstraction ? Le résultat de cette sorte d’alchimie ou d’algèbre mentale (et j’observe au passage qu’aussi bien le mot « alchimie » que le mot « algèbre » sont des mots d’origine arabe qui définissent, dans l’aire arabo-islamique, une postulation intellectuelle et/ou spirituelle) se trouve être une réversibilité d’une chose ou d’un objet en quelque autre : un pouvoir de métamorphose: les étoiles devenant des hommes, les nuages des plantes, et vice-versa. Dernière étape, au cœur de la métamorphose : le toucher de la « corde profonde », le dégagement du « rythme ». Ainsi, me paraît-il, Novalis, l’immense poète qu’est Novalis, dessine sans l’avoir réellement cherché une théorie de l’ornement, à la fois structurelle et ontologique, et qui fait de celui-ci, parcelle anonyme de la matérialité du monde confiée au soin de l’intelligence et de l’âme, le signe à la fin advenu de l’immatérialité du monde et l’irradiant témoin de la splendeur de l’Esprit, laquelle est – tous les intuitifs le disent et tous les poètes le savent – splendeur chiffrée. C’est en ce sens sans doute que Baudelaire peut écrire : « Le dessin arabesque est le plus idéal de tous ».[3]Je ne peux m’empêcher d’interpréter ici l’adjectif « idéal »– par tout ce qu’on sait du rapport de l’auteur des Fleurs du Mal avec l’art – comme l’équivalent pour lui de « spirituel ».
La théorie spirituelle de l’ornement est inscrite, en quelque sorte, dans l’ontologie de l’Islam et dans sa métaphysique. Elle fait partie de sa cosmologie, elle fait partie de sa mystique aussi bien. L’Islam étant globalité, en qui l’homme n’est jamais séparé de l’univers ni l’univers de Dieu, il ne saurait y avoir pour l’Islam de lecture séparée de n’importe lequel des aspects de l’Être. Et donc pas d’esthétique pure, mais point non plus d’interprétation des choses et des objets, des matières et des matériaux, des idées et des êtres dont on n’ose penser une seconde que puisse être exclue la beauté. Sens, témoignage, beauté : telle est la trilogie indéfiniment réversible en ses termes sur laquelle se fonde le système de réflexion de l’Islam. Réflexion qui, on le verra mieux plus loin, signifie tout autant le repli de l’intellect sur lui-même en vue de former le signe mental qui lui permet d’être en phase avec le monde que la réfraction de l’être dans le miroir où la chose et son double établissent entre eux un rapport d’identité en quoi chacun est la réalité et l’illusion de l’autre. Signe et miroir, jeux et feux croisés du Réel et de l’Illusion, symétrie d’apparence et brisure récurrente de cette même symétrie pour capter, par-delà l’ensommeillement visible de la forme en sa manifestation répétitive, le lieu sans forme où vient à se laisser piéger l’In-visible, voilà ce lieu spirituel de l’Islam en quoi peut se reconnaître, en termes de surface et d’immédiateté, une définition possible de l’ornement selon la vue que s’en fait le credo islamique. Faut-il encore citer Novalis, qui – je l’admets volontiers – n’aurait rien à voir avec notre problématique si ce n’est que, par le génie poétique, il a tout saisi de la relation existant entre les motifs de la superficie et les forces qui sont au travail dans les arcanes : « Les admirables collections et les Figures, écrit-il, […] me réjouissent; seulement, pour moi, c’est comme si elles n’étaient que […] les ornements rassemblés autour d’une merveilleuse image divine, et c’est à celle-ci que je pense toujours ». L’Islam étant, on le sait, aniconiste et, chaque fois qu’il a cru devoir l’être, iconoclaste, le mot « image », en principe du moins, ne fait partie de son vocabulaire que pour, aussitôt, être mis en cause. A ce mot, il préférera le mot « signe » – le signe lui-même étant déjà trop saturé pour lui de matière. Il faut savoir aller plus loin que le signe quand, derrière le voile que constitue celui-ci, se cache la Présence absolue. Parlant de Dieu, qui est le moteur des signes et Celui par qui ceux-ci nous sont rendus intelligibles, « Il est l’oiseau de la vision et ne se pose pas sur le signes » énonce, en un vers magnifique, le grand poète soufi du XIIIe siècle, Djelâl-Eddine Roumî. Savoir donc dépasser les signes, dépasser les ayât(s) – pour s’approcher au plus de ce que signes et ayât(s) à la fois camouflent et révèlent. On a défini l’art de l’Islam comme « une esthétique du voile ». Novalis – encore lui – pour une dernière fois : « Celui qui ne veut pas, qui n’a plus la volonté de soulever le voile, celui-là n’est pas un disciple véritable, digne d’être à Saïs ». Je ne m’appesantirai pas sur la Figure qui est la préoccupation essentielle des familiers du Maître de Saïs. Mais je parlerai des ayât(s).
*
Avant cela, il m’importe d’évoquer tel antique témoin au sujet de l’ornement qui, d’être complètement étranger à ce que sera plus tard la conception islamique en la matière, est apte à mieux éclairer celle-ci. Il ne me paraît pas que l’ornement, sinon par certaines de ces projections byzantines puis islamiques – dans l’art roman d’abord, dans l’art gothique ensuite, et sans doute même dans l’art de la Renaissance – ait réussi à se hausser en Occident au statut ontologique qui aura été sien en Islam. Ce témoin, inattendu, c’est l’antique architecte romain Vitruve qui, dans le septième livre de son Traité d’Architecture, décrit, pour en réprouver l’usage, le recours à l’ornement, en qui il ne voit qu’artifice inutile, apparence menteuse et décor oiseux, en somme rien qu’irrationalité et que délire : « Cependant – écrit-il – par je ne sais quel caprice, on ne suit plus cette règle que les anciens s’étaient prescrite, de prendre toujours pour modèles de leurs peintures les choses comme elles sont dans la vérité : car on ne peint à présent sur les murs (mais c’est dire aussi bien sur les pages) que des monstres, au lieu des images véritables et régulières. On remplace les colonnes par des roseaux qui soutiennent des enroulements de tiges, des plantes cannelées avec leurs feuillages refendus et tournés en manière de volutes ; on fait des chandeliers qui portent de petits châteaux, desquels, comme si c’étaient des racines, il s’élève quantité de branches délicates, sur lesquelles des figures sont assises ; en d’autres endroits ces branches aboutissent à des fleurs dont on fait sortir des demi-figures, les unes avec des visages d’hommes, les autres avec des têtes d’animaux ; toutes choses qui ne sont point, qui ne peuvent pas être et qui n’ont jamais existé ». Cependant, poursuit Vitruve, « ces nouvelles modes prévalent tellement aujourd’hui, qu’il ne se trouve presque personne qui soit capable de découvrir ce qu’il y a de bon dans les arts et qui en puisse juger sainement ; car quelle apparence y a-t-il que des roseaux soutiennent un toit, qu’un chandelier porte des châteaux, et que les faibles branches qui sortent du faîte de ces châteaux portent des figures qui y sont comme à cheval ; enfin que de leurs racines, de leurs tiges et de leurs fleurs il puisse y naître des moitiés de figures ? Eh bien ! malgré l’évidente fausseté de ces compositions, personne ne réprouve ces faussetés, mais on s’y plaît, sans prendre garde si ce sont des choses qui soient possibles ou non ; tant les esprits sont peu capables de connaître ce qui mérite de l’approbation dans ces ouvrages ».
On le voit : c’est au nom de la vérité, au nom d’une certaine rationalité en art que Vitruve s’élève contre l’ornementation fantastique, si présente dans l’illustration médiévale et, plus tard dans l’illustration romantique et dans l’illustration surréaliste. L’Islam aussi, ai-je dit, fera, le jour venu, de la figuration ornementale le lieu de la figuration du Vrai, mais d’un Vrai modifié et qui maintient la primauté incontestée du Véridique, le problème étant plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord. Et l’on verra bientôt l’Islam, tout en poursuivant sur la page manuscrite, mais aussi bien ailleurs, sa quête spirituelle à travers l’ornement, recourir, pour des raisons diamétralement opposées à celles qui provoquent la colère de Vitruve, à des créations de nature irrationnelle et à la fantasmagorie délirante, comme contrepoids, serais-je tenté de dire, à son dessein de vérité et à sa volonté affirmée de mainmise sur la globalité du Réel. Autrement dit encore : il va se situer au point d’intersection et d’osmose des deux dimensions simples : la matérielle et la spirituelle, celle qui est finitude du corps et celle qui est infinitude de l’âme.
Ici, il me faut tenter d’expliciter le mot âya (pluriel : ayât(s)). Ce mot, qu’on traduit généralement en français par « verset », veut dire en fait, signe ou symbole, forme visible en quoi se trouve énoncé, je crois l’avoir déjà noté, un in-visible. Le visible n’est là que pour exprimer cet invisible qu’il recèle et qu’à la fois il révèle, le signe n’étant que le témoin d’un signifié. Ce signifié absorbe le signe et le dévore et c’est de transformer le signe en énergie que vivent signe et signifié dans une symbiose active qui les fait rayonner l’un et l’autre, l’un par l’autre. Une âya peut être naturelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être linguistique, elle peut être sonore ou plastique : elle est la preuve monstrative plutôt que démonstrative de ce qu’il conviendrait d’appeler la Présence. Présence de l’Intemporel dans le temps, présence de la Transcendance dans l’espace ; présence de l’absolu du Verbe dans la langue. Un paysage de ce monde est une âya et, à vrai dire, c’est l’univers entier, témoin de la splendeur de Dieu, qui est un tissu indéfectible d’ayât(s) rayonnantes. Mais c’est le livre aussi, le Coran, qui est la parole d’Allah incarnée dans des signes – seule incarnation, d’ailleurs entièrement abstraite, que l’Islam veut bien consentir à reconnaître –, c’est donc le livre, dis-je, qui se trouve ainsi tissé d’ayât(s) « insurpassables » : cette insurpassabilité étant, au regard des Musulmans, la preuve de l’origine divine de la Parole communiquée par Allah à son Prophète « en langue arabe claire » (XXVI,195). La première parole adressée par l’Ange au pauvre homme, Muhammad, ployé sous une dictée, est : « Lis ! » (XCVI,1). Mais lui est un illettré, illettré majeur et duquel soudain on exige un déchiffrement :
Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot de sang. Lis !… Car ton Seigneur le Très-Généreux Qui a instruit l’homme au moyen du calame Et lui a enseigné ce qu’il ignorait.
(XCVI, 1-5)
Parole déterminante : face au théâtre de la Création, qui est l’oeuvre de Dieu, face au théâtre de la communication qui est l’entreprise de Dieu vers l’homme par la médiation du calame, la pointe du roseau taillée en biseau qui est dorénavant l’achèvement de tout enseignement et le début de toute re-création. Il y a le cirque du devenir où l’homme, porteur à son tour du calame, de lui instruit et par lui motivé, va s’élancer – avec l’aide de Dieu – à la conquête de tous les possibles. Ainsi, dès le premier mot prononcé par l’Ange, l’univers de l’Islam est un univers à vocation sémiologique, entièrement fait d’ayât(s), de signes et de symboles. Comment un tel univers pourrait-il être traduit dans une langue : univers en puissance de dématérialisation, langue en prise d’univers ? Y aurait-il là l’effet d’une contradiction ? Le Coran la devance, et la dépasse. Il est le Dit de Dieu fait pour être lu : son nom même, Qur’ân, signifie Lecture ; il est la Lecture par excellence. Toute lecture est générative. Elle pourrait n’être qu’un épiphénomène – sauf s’il advient qu’elle soit remembrance : c’est-à-dire qu’elle soit, au-delà du signe verbal, épaisseur ontologique. Le Coran est lu et relu : il est la mémoire vivante, en progressive accumulation, du peuple de l’Islam. Mais d’être « incréé », le Coran s’allège de tout recours à la médiation de l’humaine voix et s’inverse (se reverse) dans une autre oralité. C’est cette oralité autre, cette scansion de l’informulable que l’Islam va tenter par la médiation de ses artistes, de ses artisans et de ses calligraphes, celle aussi de ses ornementalistes de toutes disciplines et en tous genres, celle aussi bien de ses miniaturistes, oui, c’est cette oralité-là où la voix semble vouloir se retirer dans sa source éternellement présente, c’est-à-dire éternellement absente et non dite, que l’Islam, par les mille calames et instruments variés qu’il a à sa disposition, va tenter d’inscrire ses signes dans un espace et dans une durée qui, eux-mêmes, n’existent que comme projections immédiates et médiates d’un absolu réservé. Réservé, comme ces “Tables réservées” sur lesquelles est inscrit le Coran de toujours. Quand je parle d’“oralité”, j’entends aussi bien évoquer le rythme visible que saisit le regard au sens où Paul Claudel, parlant de peinture, peut intituler son livre L’Œil écoute. D’être incréé, pour le Coran, spiritualise excessivement la langue spécifique dans laquelle il lui a bien fallu prendre corps afin d’être communiqué, peut-être même afin d’être pensé : puisque toute pensée, fût-elle pensée de Dieu, suppose et supporte une médiatisation. Le sacre de la langue arabe – sacre essentiel puisqu’il va être le point de départ de l’extraordinaire efflorescence de la calligraphie et de l’arabesque dans la totalité du décor islamique, ornementation, calligraphie, et tout l’ensemble du décor attesté, – est que cette langue est le support nécessairement physique du verbe divin ; d’où s’induira pour cette langue, et pour toutes ses projections dans le visible, un statut hautement privilégié, miroir de son élection nonpareille. Et c’est pourquoi l’art de l’Islam est un art de la lumière et pourquoi aussi il ne semble se refermer sur l’inscription de son être essentiel dans le visible que pour, à l’extrême pointe de ce refermement, interrompre la clôture annoncée par une ouverture, essentielle, elle aussi, qui relance la scansion du temps dans une figuration de – et vers – l’éternel. Art du vide et du plein, du plein dans le vide et du vide dans le plein, l’un étant le contrepoint de l’autre et son révélateur aussi bien – le vide n’étant qu’une occultation instantanée du plein et le plein qu’une condensation momentanée du vide – ce type d’art, saisi par la métaphysique, vise à produire le surgissement de la Présence par la mise en contact de deux propositions de sens inverse et leur élimination fulgurante l’une par l’autre. Haute civilisation du signe, du Monde/Langue et de la Langue/Monde, de la forme ouverte d’être fermée et fermée d’être ouverte, du vide/plein et du plein/ vide, l’Islam « tel qu’en lui-même » se trouve être, avec force et détermination, la civilisation du livre. C’est très souvent dans l’ornementation du livre que la splendeur signifiante s’exprimera avec le maximum d’intensité.
*
Ayant ainsi planté le décor spirituel de l’Islam en m’appliquant à identifier, à travers ses directives d’ensemble, quelques-uns de ses signes majeurs, je souhaiterai m’intéresser de plus près, les extrayant de leur tissu ontologique d’ensemble, à un certain nombre de ses signes et symboles. Ce sera inévitablement de ma part un regard limité à quelques formulations seulement. Pourquoi ces formulations plutôt que d’autres ? Parce qu’elles me paraissent les plus caractéristiques du répertoire inépuisable des thèmes et des motifs illustrés par la civilisation islamique et qu’aussi bien ces thèmes et ces motifs – qui se perpétuent jusqu’à nos jours en terre d’Islam – ont eu, dans l’Occident chrétien, aux époques romane et gothique, c’est-à-dire sur une période de huit siècles, une influence décisive. Il me semble donc particulièrement bienvenu d’observer les ornements suivants : l’Arbre de vie, le polygone étoilé, l’arabesque et son décor, la miniature et sa complicité avec l’enluminure, la structure en miroir. Détaillons un peu.
L’un des premiers signes qui méritent, ai-je dit, d’être observés est l’Arbre de Vie. Il est présent pratiquement depuis les origines dans toutes les mythologies, dans toutes les spiritualités, dans l’ensemble des systèmes symboliques sous toutes leurs formes. Il est omniprésent dans le décor de l’Islam qui est, pour l’essentiel, un décor végétal.
L’Islam, on l’a dit, est une “civilisation de la fraîcheur”.[4] Quand les polythéistes eurent jeté Abraham, le premier Musulman selon le Livre et le père fondateur de l’Islam, dans une fournaise spécialement aménagée à cet effet : « Nous dîmes (c’est Allah qui parle) : “O feu ! sois pour Abraham fraîcheur et paix » ». Et dans la mesure où l’Islam est une religion scripturaire, profondément attachée aux indications venues de l’ordre divin et par cet ordre tout le temps modelée et modulée, c’est à créer cette impression de paix et de fraîcheur que vont concourir, en convergence de finalité, toutes les expressions artistiques de son génie. Et quoi de plus frais, de plus vrai aussi, puisque l’art a pour dessein la vérité – fût-ce à travers l’évocation et l’appel à la poésie – que la fleur, que l’arbre, que la tresse et que l’arabesque feuillue, que l’eau et la représentation de l’eau, que la couleur unie contrastant avec d’autres couleurs unies en oppositions à la fois joyeuses et vives, que la nudité de l’espace préoccupé exclusivement de rythmer l’ombre méditative et la lumière filtrée, que le souvenir de l’élément liquide solidifié dans les alvéoles et les stalactites des muqarnâs, que l’accompagnement du texte manuscrit de lettrines et de guirlandes fleuries et, dans les exemplaires précieux du Coran, la séparation des versets par de petites rosaces d’or qui font de la page une prairie abstraite. Le décor d’une page (ou d’un tapis), outre l’Arbre de Vie, qui souvent est là stylisé, est envahi d’un semis de figures métamorphosées en gemmes, selon ce qu’en dira Louis Massignon dans son bref essai majeur sur « les méthodes de réalisation artistique des peuples de l’Islam », paru dans la revue Syria en 1921. Si l’interdiction de toute représentation de figure animée est la règle (l’orientaliste suisse Titus Burckhardt[5] parle de « l’aniconisme » de l’Islam), reste que certains sujets rencontrent moins d’opposition que d’autres : ceux où ne résident aucun esprit vivant, « arbres, fleurs et choses ». A partir de quoi une habile exégèse, se fondant sur certains hadîths, a étendu le champ de la représentation : pour placer dans une miniature, par exemple, et au milieu de cet espace en fleurs que généralement elle représente, l’image d’un être animé, il suffira – si l’on peut dire – de le « géométriser », de le mutiler ou de le rendre inidentifiable en lui ôtant tout caractère particulier, ne retenant de lui que le plus général, le privant de toute épaisseur, de manière à le rendre manifestement inapte à exprimer la vie dans sa tonalité vibrante et chaude. Retenons le propos du célèbre jurisconsulte Ibn-Abbâs en réponse à un miniaturiste qui l’interroge : « Mais quoi ? Ne pourrai-je plus peindre d’animaux ? Ne pourrai-je plus exercer mon métier ? » – « Que si », lui dit Ibn-Abbâs, « mais tu dois décapiter les animaux pour qu’ils n’aient plus l’air vivant et tâcher de faire qu’ils ressemblent à des fleurs ». Dans tous les arts musulmans, et même en poésie, il y a ce que Massignon a superbement baptisé « une descente de la métaphore ». C’est là un processus paradoxal dont l’objectif est d' »inanimer » l’animé : l’homme est comparé à tel ou tel animal, l’animal à une fleur, la fleur à une pierre précieuse : « Une tulipe est un rubis ». Quand, par exemple, le poète Imrou’el Quays qui est antérieur à l’Islam – mais l’imaginaire arabe est une continuité – évoque telle « fleur tachetée », c’est en fait la plaie sanglante d’une gazelle, tirée à l’arc qu’il entend décrire.
Passons maintenant à cette autre figure prédominante de l’art de l’Islam : le polygone étoilé. Comme son nom l’indique, ce type de polygone a pour référence l’étoile et l’on sait, comme pour l’Arbre de Vie, le rôle majeur joué par l’astre dans nos histoires, nos cultes et nos légendes. L’étoile à cinq branches est le symbole du microcosme humain ; l’étoile à six branches, avec ses deux triangles inversés, dit l’étreinte de l’esprit et de la matière, des principes actif et passif, le rythme de leur dynamisme, la loi de l’évolution et de l’involution. Unissant le carré et le triangle, l’étoile à sept branches participe du symbolisme du chiffre sept, chiffre prégnant, s’il en est, et, pour l’essentiel, elle exprime l’harmonie du monde et tout ce qui relève d’un rapport juste entre les choses, entre les êtres, entre les êtres et les choses, ou encore entre la terre et le ciel. Dans le domaine islamique, telle sourate du Coran est intitulée L’Etoile (LIII), telle autre l’Astre Nocturne (LXXXVI) et telle autre Les Constellations (LXXXV). Le polygone, comme d’ailleurs le polyèdre, dont l’ornementation architecturale de l’Islam fera grand usage, naît de la combinaison d’un carré et d’un cercle (ou d’une sphère), et des nombreuses formes qui peuvent dériver de cette combinaison initiale. Cette mise en relation de deux figures élémentaires fait du polygone étoilé ce qu’Ernst Diez a appelé un « art de la simultanéité »[6]. Jacques Berque y perçoit même, par « la virtuosité poussée jusqu’au sophisme »[7] , une dimension baroque introduite dans le géométrisme de l’espace du fait de la tension provoquée par ce mariage inattendu, tension maintenue, amplifiée même par la redondance et la récurrence du motif.
J’ai déjà à plusieurs reprises dans le cours de cette réflexion, évoqué l’arabesque, et j’y reviendrai encore en conclusion de cet exposé, quand je parlerai de la calligraphie. L’arabesque, comme son nom l’indique, est lié à ce qu’il y a de plus fondamental dans l’art et le décor arabo-islamiques. Elle est signe et symbole, abstraction, durée sans épaisseur s’inscrivant dans le temps sans temps, horizontalité porteuse de verticalité ontologique et, de ce fait, annulant l’espace qui lui sert d’appui et de support, ligne dénoncée à mesure qu’elle est énoncée et à nouveau s’énonçant à l’instant qu’elle semble s’effacer, calame de l’homme faisant réponse au calame d’Allah, lui aussi, lui surtout, inépuisable :
Si la mer est une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur la mer serait assurément tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur même si nous apportions encore une quantité d’encre égale à la première.
(XVIII, 109)
L’arabesque, on le sait, vient de plus loin que l’art proprement arabe, qui pourtant lui aura donné son nom. Si l’arabesque à formes végétales, comme l’a noté Titus Burckhardt, semble dériver de l’image de la vigne « dont les rinceaux entrelacés – écrit-il – et les pampres enroulés se prêtent tout naturellement à une stylisation en formes ondulées et spiraloïdes », il n’en reste pas moins qu’avant d’être la projection sur une surface plane de l’Arbre de Vie », de la frise bacchique ou du chapiteau corinthien, elle existait déjà dans les arts de l’Asie centrale, dans « l’art zoomorphe » (Tierstil) des Scythes et des Sarmates et dans la double spirale du symbole chinois du yin-yang. Vagues de la mer ici, se déroulant l’une à la suite de l’autre, pourchas l’un de l’autre d’animaux identiques indéfiniment recommencés, pampres et vrilles helléniques et hellénistiques attendant d’être intégrées au symbolisme chrétien, l’arabesque va envahir, mêlée ou non à la calligraphie tout le décor de l’Islam, notamment en matière de l’illustration du livre. Intense dessèchement lyrique de telle écriture volontairement dépouillée, luxuriance fleurie de telle autre dont chaque lettre se fait hampe végétale, corolle déployée, plante épanouie. Souvent abstraite au début, l’arabesque se changera, selon le génie géométrique qui est souvent le sien, de références visuelles identifiables et, sinon la scripturaire qui est de par sa nature liée à la reproduction aussi lisible que possible des versets du Coran, de toutes sortes d’allusions aux modes de la vie, dans leur pouvoir de « cristallisation » algébrique ou logarithmique en quoi se retrouve cette notion de rythme si fondamentale à l’art de l’Islam. Il faudrait dire aussi que, du fait du retour progressif de l’Islam à sa pureté originelle sous la pression des rigoristes de plus en plus exigeants, l’arabesque, vers la fin de son développement millénaire, semble parfois, ici ou là, retrouver le chemin du dépouillement le plus sévère, au risque de voir se stériliser sa puissance inventive. Il faudrait enfin rappeler l’extraordinaire prégnance de cette projection décorative sur l’art médiéval européen, roman aussi bien que gothique, surtout gothique, et plus tard – malgré le retour de l’art gréco-romain et malgré l’intrusion de la perspective – dans l’art de la Renaissance. Pour ce qui est de l’art médiéval, je renvoie au beau livre de Jurgis Baltrusaitis, Le Moyen-Age fantastique : antiquités et exotismes dans l’art gothique[8] qui me paraît, en deux chapitres (II et IV), constituer un répertoire complet des thèmes, motifs ou figures empruntés par la chrétienté à l’art arabo-musulman.
« Dans le domaine du décor de la vie, l’Orient jouit d’un prestige légendaire », écrit notamment Baltrusaitis, citant pêle-mêle les clerici transmarini, l’enseignement du « sarrazinois », les traités d’astrologie arabe, ceux de médecine, de mathématiques ou d’optique, les grands philosophes arabes transmetteurs, entre autres, de l’antique philosophie grecque – sans compter tout ce qu’offre à l’Europe l’Andalousie si proche. Dans le domaine proprement ornemental, voici les frises du Psautier de Saint-Louis (1254-1270), celles de l’Apocalypse de Saint-Sever (1028-1072), voici les bandeaux portant les mots Mach’Allah, « ce qu’Allah veut », sur la porte de bois de la Voûte-Chilhac, voici les émaux de Limoges (vers 1225-1230) décorés de fleurs et de rosaces, voici les lettres gothiques ornées de fleurons et de palmettes à la manière des lettres coufiques, les entrelacs, les polygones étoilés et les carrés polylobés de l’Islam, les tondi, gruppi di cordi, gruppi mouschi, urabeschi ou cordelle alla damaschina qui fascinèrent jusqu’à Bramante (coupole de Sainte-Marie-des-Grâces de Milan), Léonard de Vinci (plafond de la Sala delle Asse du château Sforza) et Dürer qui les recopiera chez Léonard. Peut-être faut-il encore citer le caractère en demi-feuille rûmi si présent partout dans l’art gothique, les ornements à franges du Missel de Luçon (fin du XIXe siècle), ou ceux du Bréviaire de Belleville, par Jean Pucelle (1330-1340). Baltrusaitis parle en outre fort savamment des monstres hiératiques, des entrelacs vivants, du rûmi zoomorphique, des bêtes sans membres, des rinceaux à têtes et à troncs, du naskhi, style d’écriture anthropomorphe, du wakwak, d’autres thèmes fantastiques, et de ce fait profondément poétiques déjà surréalistes en quelque sorte, comme l’arbre du Soleil et de la Lune, l’arbre héraldique du Mal, l’arbre alchimique, l’arbre du conflit de l’âme . Dans le décor proprement épigraphique, de tels motifs inscrits en marge de l’illustration centrale sont l’oeuvre du mudhabbib ou doreur, à ne pas confondre avec le miniaturiste — comme l’art gothique, lui aussi, suivant en cela la tradition islamique, distinguera, du miniaturiste, l’enlumineur.
J’ai déjà évoqué l’art de la miniature qui accompagne de ses illustrations somptueuses tant d’évocations de textes sacrés et poétiques que des chefs-d’œuvre de la littérature arabe ou persane ou indienne du nord, le Voyage Nocturne de Mahomet et les Mille et Une Nuits d’une part ou l’épopée du Chah-Nâmeh d’autre part. J’ai dit quelques-unes des spécificités que cet art revêtait en Islam. Malgré son nom minimaliste, la miniature est un art majeur, avec une histoire, avec des variations et des influences, avec des styles. Certains historiens de l’art ont même été jusqu’à réduire à la miniature, art considéré par eux comme le plus représentatif, l’ensemble de la formulation plastique arabo-islamique. Quelle erreur, et quelle vue courte ! C’est – on ne le dira jamais assez – du jour où il acheta une miniature persane sur les quais de la Seine qu’Ingres deviendra Ingres (de même, d’ailleurs, qu’un siècle plus tard, c’est à contempler des tapis au soleil de Kairouan, en Tunisie, que Klee deviendra Klee). Du jour où il acquit cette œuvrette dans une échoppe du quai Malaquais, le maître du « Bain turc » allait découvrir ceci : que la ligne avait une existence autonome et que, porteuse d’un dynamisme propre, elle était féconde solitairement et, à la façon de l’arabesque – cette arabesque qu’aimera tant Matisse après lui – : elle pouvait n’être que rythme, c’est-à-dire le tout de l’art. Ce jour-là, pour Ingres et sa postérité, tout devenait possible – et les plus excessives déformations, les deux vertèbres ajoutées, par besoin de fluide et longue harmonie, à l’épine dorsale de l' »Odalisque », les saisissants télescopages de Picasso, le sein pointant du sommet de l’épaule…
La miniature arabo-islamique n’appartient donc pas seulement au domaine du sacré, loin de là. Cependant elle participe de l’ambiance générale de l’art islamique qui est, on le sait de reste, polarisé par l’abstraction. Alors que l’art occidental, notamment à partir de la Renaissance, va s’efforcer de donner une vision prétendument « objective » du monde, réalisme et perspective – mais ce « réalisme » n’est que dans l’œil du peintre et la « perspective » n’est que l’effet accidentel de sa propre position face aux choses : une convention « mentale » comme le souligne Léonard de Vinci –, le regard de l’artiste musulman sur le monde sera, délibérément et dès l’origine, un regard libre de toute sujétion à l’égard de quelque « réel » que ce soit. L’espace de la miniature est à deux dimensions et il est arbitrairement divisé ; la couleur y est pure et point modulée ; les objets et les êtres sont vus et définis non selon des signes distinctifs, mais en leur qualité de représentants anonymes d’une catégorie existentielle. Ce qui est vrai des personnages des Mille et Une Nuits l’est aussi des personnages – des miniatures. De ces personnages, littéraires ou picturaux, j’ai écrit dans mon livre Archer aveugle[9] : «[…] Ce sont autant de figures d’un jeu d’échecs, figures emblématiques, que l’on verra manoeuvrer dans le cadre du récit, qu’il fût fragment des Mille et Une Nuits, maqamât de Harini ou de Badi ez-Zamâne el-Hamazâni, ou même, puisque leur ensemble fut récupéré par l’imaginaire arabe qui s’y plut à s’y reconnaître, fables du Baïdaba (Pilpay). Figures symboliques et comme interchangeables, à la manière de celles qu’on voit délicieusement peintes dans les miniatures persanes et turques où chacun, le faste plus ou moins grand du costume mis à part, ressemble, dans sa tranche d’âge, à chacun. Ainsi l’espace islamique est-il, comme le temps islamique, une catégorie immuable où jouent seulement, au regard de l’attention, d’exquises variations pareilles à ces précipitations qui courent, en musique, à la périphérie du thème.
Une représentation figurée particulièrement inattendue est celle qui concerne l’arbre à têtes, dérivé de l’Arbre de Vie : entrelacs, tresses, frises, arabesques, rinceaux, tissus, vont se peupler d’éléments zoomorphiques ou anthropomorphiques. Certes, ce sont toujours des créatures rendues fantasques ou fantasmatiques, c’est-à-dire inaptes à la vie, par le style même de leur figuration : forme semi-animales, semi-végétales entremêlées, bêtes sans pattes, bustes humains greffés sur des lettres en demi-feuilles, écriture naskhi (à savoir cursive) apprivoisant un vrai bestiaire onirique.
Voici l’Arbre de Vie transformé en arbre de la Mort, en arbre de l’Enfer. L’animal, l’homme du Mal lui-même vont trouver une vélocité nouvelle et une alacrité saisissante dans ce théâtre de la dérision : « L’animal n’est pas anéanti par l’abstraction. – écrit Baltrusaitis – Tout au contraire, les angles et les courbes semblent l’inciter à la mobilité. Aussi la bête ne tardera-t-elle pas à s’évader de ces méandres réguliers et à défaire la tresse où elle est née ». Et plus loin : « Les têtes les plus diverses s’attachent aux tiges : têtes barbues, cornues, à longues oreilles de lièvre, têtes d’âne, de renard, de chien, de bœuf, têtes de serpents ou de poisson, têtes d’hommes. fixées sur les rameaux flexibles, elles s’y balancent comme d’énormes fruits. Il suffit bien d’une plante, monstrueusement épanouie et non d’un animal-rinceau ou demi-feuille […] Les bourgeons explosent sur toutes les branches. Les gueules se multiplient, se pressent en cohue. Sur le plumier de la collection Marquet de Vasselot, on en compte vingt, par groupe de deux rinceaux, et sur le bassin d’un sultan ayyoubide (1249), une rosace polylobée en comporte à elle seule vingt-six. Depuis longtemps, floraison aussi sauvage ne s’était vue.» Parmi les animaux ou les plantes fantastiques, il y a, qui auront, eux aussi, une postérité considérable dans l’imaginaire occidental, les animaux et les motifs floraux « affrontés », accouplés dans la symétrie et placés, pour l’éternité, en miroir. Surréalisme, donc, avant la lettre.
L’Islam est de fait une civilisation du miroir : miroir l’algèbre, miroir la géométrie, miroir les indéfinies, les infinies récurrences de l’art islamique dans la diversité de ses inspirations et de ses techniques. Quoi de plus matérialisant et quoi de plus dématérialisant que le miroir qui ne recueille le donné du réel que pour, ce réel, réduit à l’apparence, le rendre plus illusoire encore ? Le monde est le reflet de Dieu, disent les textes de tous les grands maîtres soufis. Je ne retiendrai qu’un seul témoignage de ce type de vision, c’est un étonnant apologue de Djelâl-Eddine Roumî tiré du Mathnavî qui, mieux que toute analyse, parvient à formuler l’essentiel de ce qui fait la lumière et le mystère de l’art islamique, art qui, derrière le voile de la forme abstraite ou semi-figurée, attend tout de la lumière d’en-haut ou de celle d’en face : « Un jour, un sultan appela à son palais des peintres, venus les uns de la Chine, les autres de Byzance. Les Chinois prétendaient être les meilleurs des artistes ; les Grecs, de leur côté, revendiquaient la précellence de leur état. Le Sultan les chargea de décorer à fresque deux murs qui se faisaient face. Un rideau séparait les deux groupes de concurrents qui peignaient chacun une paroi sans savoir ce que faisaient leurs rivaux. Mais, tandis que les Chinois employaient toutes sortes de peintures et déployaient de grands efforts, les Grecs se contentaient de polir et lisser sans relâche leur mur. Lorsque le rideau fut tiré, l’on put admirer les magnifiques fresques des peintres chinois se reflétant dans le mur opposé qui brillait comme un miroir. Or, tout ce que le Sultan avait vu dans le mur des Chinois semblait beaucoup plus beau, reflété sur celui de Grecs ».
*
Concluons.
J’ai évoqué quelques-uns des signes de l’Islam, dans leur projection dans l’art – art interne à l’Islam, art externe – et je me dis à nouveau et pour me résumer, que celui-ci est, au-delà de toute cette substance et à travers bien des paradoxes, la civilisation du signe.
La calligraphie arabe, très particulièrement, l’une des plus déterminantes, artistiquement parlant, dans le décor de la vie et du livre, se trouve être le témoin privilégié du surgissement de l’esprit et de son accession à l’immanence. La sérénité de la main, et son élégance, traduisent à leur façon la pesanteur et la légèreté des permanences. Le retour du signe sur lui-même, autrement dit son élaboration qui, parfois, se complique harmoniquement jusqu’à l’illisibilité – illisibilité du premier niveau mais lisibilité majeure au second et au troisième niveau, celui de la préhension par le rapt d’aigle du regard tourné vers le dedans – cette élaboration complexe et compliquée exprime assez, par l’annulation obtenue de la figure immédiate, la majesté de l’intemporel. Et lorsque vers la fin de la grande période classique le calligraphe s’adonne quelquefois à l’art de mimer savamment par l’écriture le signe épiphanique de l’objet ou du concept évoqués, il cède à une tentation de nature nominaliste, assez présente dans le déploiement des stratégies philosophiques de l’Islam où la chose désignée et le nom désignant tendent à se confondre. Une dernière observation à ce sujet, pour énoncer qu’il n’est rien de plus contraire à l’esprit du calligraphe islamique que celui du calligraphe zen, lui aussi agent et témoin d’une tradition spirituelle de haute volée : là où le musulman veut signifier, par le tour et le détour de la ligne, la patience de l’éternité, le mystique japonais, aujourd’hui très en faveur auprès des amateurs d’art, veut, comme par le geste bref du voleur de feu – brusque déchirement du tissu invisible au profit d’une parousie du mental – dire l’intuition d’un instant radical en qui se résument et se résolvent les contradictions dramatiques de l’Être, et le geste lui-même du calligraphe participe à cette dramatisation. J’affirme, en revanche, que la main du calligraphe musulman est médiatrice d’un calme en infinitude.
Ce même calme, cette même infinitude, règlent le rituel mille fois semblable à lui-même de l’arabesque, reprise de la vague par la vague pour exprimer symboliquement en surface la profondeur incommensurable de l’Océan : « Tant de sommeil sous un voile de flamme », écrit, dans un autre contexte, Paul Valéry. J’ai moi-même noté dans mon ouvrage La Unième Nuit[10], que l’arabesque, interruption interrompue, rupture indéfiniment réunifiante, était l’une des clés modulatrices de l’imaginaire islamique, à la manière, pourrait-on penser, des Mille et Une Nuits, récit dans le récit, mise en abîme d’un réel qui, d’être ainsi réfléchi de miroir en miroir, devient mythique. Le peu de réalité, c’est la réalité frappée de nullité par la nostalgie dévorante de l’Être. Revenant à l’arabesque, je dirai que l’une des inventions les plus saisissantes de la créativité plastique de l’Islam aura été l’intégration l’une dans l’autre de l’arabesque et de la calligraphie, magnifiquement complémentaires et convergentes dans leur vœu d’unité.
Cette même convergence, cette même cohérence des signes, c’est cela qui distingue une culture et qui en constitue, face à d’autres convergences, à d’autres cohérences, la spécificité. Certes, il n’y a pas lieu de s’appesantir sur la correspondance des signes entre les civilisations et les cultures comme sur autant de feux qui se répondraient d’un rivage à l’autre et, pourquoi pas ? d’un monde à l’autre : énoncé approximatif pour exprimer la division seulement d’apparence là où n’existent qu’une continuité, qu’une instantanéité ontologiques. Et l’instant, en Islam, n’est pas l’instant : il est, aussi bien, le Tout. L’image, aussi bien, n’est pas l’image, l’ornement n’est pas l’ornement : ils sont, par la médiation de toute création « imaginaire », le point de fulguration de l’inimaginable et de l’inimaginé ou, mieux, de l’inimagé. Il reste que, civilisation négatrice et négatrice doublement pour une meilleure affirmation par la shahâda, par le lâ illah illa’ Llâh, de la pérennité du Seul Perdurable, l’Islam – qui inventa entre autres l’algèbre – n’a à sa disposition, pour communiquer et pour se communiquer, que le dessèchement admirablement fertile de ses signes déployés à tous nos horizons essentiels.
Salah Stétié
[1] Traduction due à Denise Masson, la Pléiade, Gallimard. [2] Traduction d’Armel Guerne. [3] Charles Baudelaire : Fusées. [4] La formule est de Gabriel Bounoure. [5] Cf. son remarquable ouvrage : L’art de l’Islam, langage et signification, paru aux Editions Sindbad en 1985 [6] Ernst Diez, Simultneity in Islamic art, Art Islamica, tome IV, 1937. [7] Jacques Berque, De l’Euphrate à l’Atlas, tome 2 : Histoire et nature », Sindbad, 1978. [8] Armand Colin, édit. [9] Salah Stétié : Archer aveugle, Fata Morgana, 1985. [10] Salah Stétié, La Unième Nuit, Stock, 1980, repris dans En un lieu de brûlure, anthologie d’œuvres de l’auteur, paru dans la collection « Bouquins », Robert Laffont, 2009.
<
Hot Deals!
by DropDownDeals®
L’ORNEMENT, LIEU SPIRITUEL DE L’ISLAM
À ma connaissance, aucun des principaux spécialistes de l’art de l’Islam ne l’a jamais mentionnée, ni même y a fait allusion dans le cours de ses analyses : et pourtant, il y a dans le Coran une sourate intitulée « L’Ornement » (XLIII). Elle tire essentiellement son nom des ayât(s) ou versets suivants :
Nous aurions placé, dans leurs maisons, [les hommes] des portes, des lits de repos sur lesquels ils s’accorderaient et maint ornement.
Mais tout cela n’est que jouissance éphémère de la vie de ce monde La vie dernière, auprès de ton Seigneur, appartient à ceux qui le craignent[1] (34 – 35)
On le voit : l’ornement a droit de cité dans le Coran qui est la parole même d’Allah révélée à son serviteur Muhammad. De ce fait, il a, malgré sa nature apparemment secondaire, un statut éminemment ontologique qui fait de lui, en Islam, une entité à part entière. On sait que le Coran, comme Platon auparavant, prend position contre les poètes qui sont « suivis par ceux qui s’égarent ». Et pourtant le Coran autour duquel a longtemps tourné, et tourne toujours, la vie spirituelle, intellectuelle et artistique des communautés et des peuples de l’Islam, est, entre autres, qu’il le veuille ou non, un livre de très haute portée poétique, ne fût-ce déjà que par la forme et le recours au verset assonancé, avec, en plus de cette caractéristique interne, un décor de présentation esthétique qui, très souvent, dans l’abstraction de ses signes plastiques et l’élégance de sa calligraphie, atteint au chef-d’œuvre.
L’ornement est surface, le monde profondeur. Ce serait là sans doute banalité s’il n’était justement arrivé à l’ornement, par la médiation de l’Islam, de devenir la profondeur du monde; si la surface, autrement dit, n’était devenue l’éclat de la dimension spirituelle. Tel est le sens, dans tout ce qui suivra, de mon propos : il s’agira pour moi, on l’aura compris, de montrer la logique cachée de cet étonnant paradoxe. Et puisque paradoxe il y a, ce n’est pas seulement à la doctrine islamique que je me contenterai de demander une illustration de l’ornement – dans son rapport avec le monde, ainsi qu’avec le livre – mais je ferai également appel à un texte poétique célèbre du romantisme allemand –, convaincu que je suis de l’existence de nombreuses et puissantes convergences dans l’imaginaire humain.
On lit, en effet, dans les Disciples à Saïs de Novalis : « Peu après quelqu’un énonça : « L’Écriture Sainte n’a besoin d’aucune explication. Celui qui parle vrai, celui-là est plein de la vie éternelle et ses écrits nous paraissent être en prodigieuse affinité avec les authentiques mystères, car ils sont un accord de la symphonie de l’Univers. C’est assurément de notre maître que cette voix parlait, car il a l’intelligence de la synthèse et sait rassembler les traits qui sont pourtant épars. Un éclat particulier flamboie dans son regard lorsque, justement devant nous, les hautes runes se découvrent, et qu’alors il guette dans nos yeux et attend que se lève l’étoile, en nous aussi, qui doit nous rendre évidente et intelligible la Figure. »
Je reviendrai plus loin sur le rapport essentiel qui est celui, en Islam, de l’Étoile et de la Figure : autant du point de vue ontologique que du point de vue ornemental. Et, puisque se trouve évoquée la notion de figure, je dirai que la figure centrale de l’art islamique est, incontestablement, le polygone étoilé qui va accompagner de ses variations et de ses complications de plus en plus savamment élaborées, aussi bien en Orient qu’en Occident, tout le développement de cet art.
Mais revenons à Novalis : «Souvent il (le Maître) nous conta comment, lorsqu’il était enfant, son penchant à faire jouer ses sens, le soucis de s’occuper d’eux et de les satisfaire, ne lui laissaient aucun loisir. Il contemplait les étoiles et reproduisait sur le sable leur position et leur course. Sans repos il plongeait son regard dans l’océan des âmes, admirant sa transparence, ses mouvements, ses nuages, ses lumières ; et sa contemplation ne connaissait pas de fatigue. Il recueillait et assemblait des pierres, des fleurs, des scarabées de toutes sortes, les rangeait de diverses manières, en files, en séries. En lui il épiait le mouvement de ses pensées et de ses sentiments. Il ne savait pas où le poussait son immense désir.» Et pourtant si, dirai-je : il le sait. Novalis n’ajoute-t-il pas quelques lignes plus bas : « À présent il retrouve partout des choses connues – mêlées seulement et appariées étrangement – et ainsi, souvent, des choses s’ordonnaient d’elles-mêmes en lui, extraordinaires et rares. De bonne heure, en tout, il remarquait les combinaisons, les rencontres, les coïncidences. Il finit par ne voir plus rien isolément. Les perceptions de ses sens se pressaient en grandes images colorées et diverses : il entendait, voyait, touchait et pensait en même temps. Il se réjouissait à assembler les choses étrangères. Tantôt les étoiles étaient des hommes, tantôt les hommes des étoiles, les pierres des animaux, les nuages des plantes, […] il jouait avec les forces et les phénomènes ; il savait où et comment trouver ceci et cela, et il pouvait le laisser apparaître; et c’est ainsi qu’il touchait lui-même aux cordes profondes, cherchant sur elles et s’approchant des sons purs et des rythmes»[2]
Le point d’aboutissement de cette lecture de surface du monde par le Maître, c’est – par le long questionnement, par la lente incubation – l’apparition, sur cette même surface, iris de l’œil, tympan de l’ouïe, des « sons purs et des rythmes ». Plusieurs des opérations décrites par Novalis dans ce texte superbe et révélateur – au sens comme photographique du terme – me paraissent donner à l’ornement, au-delà de son statut épigraphique, sa dignité ontologique. Ne s’agit-il pas, d’abord, de s’investir totalement dans la longue contemplation du monde pour, en somme, s’en laisser pénétrer ? Puis, à partir de prises de détail(s) – une pierre, une fleur, un scarabée – d’imaginer les « files » et les « séries » en quoi et par quoi ces détails prendront figure d’ensemble, toute mise en forme d’une totalité exigeant immanquablement la disparition du détail en tant que tel, son abolition mallarméenne, son élévation à quelque rang plus pur de lui-même, son extraction suivie de son abstraction ? Le résultat de cette sorte d’alchimie ou d’algèbre mentale (et j’observe au passage qu’aussi bien le mot « alchimie » que le mot « algèbre » sont des mots d’origine arabe qui définissent, dans l’aire arabo-islamique, une postulation intellectuelle et/ou spirituelle) se trouve être une réversibilité d’une chose ou d’un objet en quelque autre : un pouvoir de métamorphose: les étoiles devenant des hommes, les nuages des plantes, et vice-versa. Dernière étape, au cœur de la métamorphose : le toucher de la « corde profonde », le dégagement du « rythme ». Ainsi, me paraît-il, Novalis, l’immense poète qu’est Novalis, dessine sans l’avoir réellement cherché une théorie de l’ornement, à la fois structurelle et ontologique, et qui fait de celui-ci, parcelle anonyme de la matérialité du monde confiée au soin de l’intelligence et de l’âme, le signe à la fin advenu de l’immatérialité du monde et l’irradiant témoin de la splendeur de l’Esprit, laquelle est – tous les intuitifs le disent et tous les poètes le savent – splendeur chiffrée. C’est en ce sens sans doute que Baudelaire peut écrire : « Le dessin arabesque est le plus idéal de tous ».[3]Je ne peux m’empêcher d’interpréter ici l’adjectif « idéal »– par tout ce qu’on sait du rapport de l’auteur des Fleurs du Mal avec l’art – comme l’équivalent pour lui de « spirituel ».
La théorie spirituelle de l’ornement est inscrite, en quelque sorte, dans l’ontologie de l’Islam et dans sa métaphysique. Elle fait partie de sa cosmologie, elle fait partie de sa mystique aussi bien. L’Islam étant globalité, en qui l’homme n’est jamais séparé de l’univers ni l’univers de Dieu, il ne saurait y avoir pour l’Islam de lecture séparée de n’importe lequel des aspects de l’Être. Et donc pas d’esthétique pure, mais point non plus d’interprétation des choses et des objets, des matières et des matériaux, des idées et des êtres dont on n’ose penser une seconde que puisse être exclue la beauté. Sens, témoignage, beauté : telle est la trilogie indéfiniment réversible en ses termes sur laquelle se fonde le système de réflexion de l’Islam. Réflexion qui, on le verra mieux plus loin, signifie tout autant le repli de l’intellect sur lui-même en vue de former le signe mental qui lui permet d’être en phase avec le monde que la réfraction de l’être dans le miroir où la chose et son double établissent entre eux un rapport d’identité en quoi chacun est la réalité et l’illusion de l’autre. Signe et miroir, jeux et feux croisés du Réel et de l’Illusion, symétrie d’apparence et brisure récurrente de cette même symétrie pour capter, par-delà l’ensommeillement visible de la forme en sa manifestation répétitive, le lieu sans forme où vient à se laisser piéger l’In-visible, voilà ce lieu spirituel de l’Islam en quoi peut se reconnaître, en termes de surface et d’immédiateté, une définition possible de l’ornement selon la vue que s’en fait le credo islamique. Faut-il encore citer Novalis, qui – je l’admets volontiers – n’aurait rien à voir avec notre problématique si ce n’est que, par le génie poétique, il a tout saisi de la relation existant entre les motifs de la superficie et les forces qui sont au travail dans les arcanes : « Les admirables collections et les Figures, écrit-il, […] me réjouissent; seulement, pour moi, c’est comme si elles n’étaient que […] les ornements rassemblés autour d’une merveilleuse image divine, et c’est à celle-ci que je pense toujours ». L’Islam étant, on le sait, aniconiste et, chaque fois qu’il a cru devoir l’être, iconoclaste, le mot « image », en principe du moins, ne fait partie de son vocabulaire que pour, aussitôt, être mis en cause. A ce mot, il préférera le mot « signe » – le signe lui-même étant déjà trop saturé pour lui de matière. Il faut savoir aller plus loin que le signe quand, derrière le voile que constitue celui-ci, se cache la Présence absolue. Parlant de Dieu, qui est le moteur des signes et Celui par qui ceux-ci nous sont rendus intelligibles, « Il est l’oiseau de la vision et ne se pose pas sur le signes » énonce, en un vers magnifique, le grand poète soufi du XIIIe siècle, Djelâl-Eddine Roumî. Savoir donc dépasser les signes, dépasser les ayât(s) – pour s’approcher au plus de ce que signes et ayât(s) à la fois camouflent et révèlent. On a défini l’art de l’Islam comme « une esthétique du voile ». Novalis – encore lui – pour une dernière fois : « Celui qui ne veut pas, qui n’a plus la volonté de soulever le voile, celui-là n’est pas un disciple véritable, digne d’être à Saïs ». Je ne m’appesantirai pas sur la Figure qui est la préoccupation essentielle des familiers du Maître de Saïs. Mais je parlerai des ayât(s).
*
Avant cela, il m’importe d’évoquer tel antique témoin au sujet de l’ornement qui, d’être complètement étranger à ce que sera plus tard la conception islamique en la matière, est apte à mieux éclairer celle-ci. Il ne me paraît pas que l’ornement, sinon par certaines de ces projections byzantines puis islamiques – dans l’art roman d’abord, dans l’art gothique ensuite, et sans doute même dans l’art de la Renaissance – ait réussi à se hausser en Occident au statut ontologique qui aura été sien en Islam. Ce témoin, inattendu, c’est l’antique architecte romain Vitruve qui, dans le septième livre de son Traité d’Architecture, décrit, pour en réprouver l’usage, le recours à l’ornement, en qui il ne voit qu’artifice inutile, apparence menteuse et décor oiseux, en somme rien qu’irrationalité et que délire : « Cependant – écrit-il – par je ne sais quel caprice, on ne suit plus cette règle que les anciens s’étaient prescrite, de prendre toujours pour modèles de leurs peintures les choses comme elles sont dans la vérité : car on ne peint à présent sur les murs (mais c’est dire aussi bien sur les pages) que des monstres, au lieu des images véritables et régulières. On remplace les colonnes par des roseaux qui soutiennent des enroulements de tiges, des plantes cannelées avec leurs feuillages refendus et tournés en manière de volutes ; on fait des chandeliers qui portent de petits châteaux, desquels, comme si c’étaient des racines, il s’élève quantité de branches délicates, sur lesquelles des figures sont assises ; en d’autres endroits ces branches aboutissent à des fleurs dont on fait sortir des demi-figures, les unes avec des visages d’hommes, les autres avec des têtes d’animaux ; toutes choses qui ne sont point, qui ne peuvent pas être et qui n’ont jamais existé ». Cependant, poursuit Vitruve, « ces nouvelles modes prévalent tellement aujourd’hui, qu’il ne se trouve presque personne qui soit capable de découvrir ce qu’il y a de bon dans les arts et qui en puisse juger sainement ; car quelle apparence y a-t-il que des roseaux soutiennent un toit, qu’un chandelier porte des châteaux, et que les faibles branches qui sortent du faîte de ces châteaux portent des figures qui y sont comme à cheval ; enfin que de leurs racines, de leurs tiges et de leurs fleurs il puisse y naître des moitiés de figures ? Eh bien ! malgré l’évidente fausseté de ces compositions, personne ne réprouve ces faussetés, mais on s’y plaît, sans prendre garde si ce sont des choses qui soient possibles ou non ; tant les esprits sont peu capables de connaître ce qui mérite de l’approbation dans ces ouvrages ».
On le voit : c’est au nom de la vérité, au nom d’une certaine rationalité en art que Vitruve s’élève contre l’ornementation fantastique, si présente dans l’illustration médiévale et, plus tard dans l’illustration romantique et dans l’illustration surréaliste. L’Islam aussi, ai-je dit, fera, le jour venu, de la figuration ornementale le lieu de la figuration du Vrai, mais d’un Vrai modifié et qui maintient la primauté incontestée du Véridique, le problème étant plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord. Et l’on verra bientôt l’Islam, tout en poursuivant sur la page manuscrite, mais aussi bien ailleurs, sa quête spirituelle à travers l’ornement, recourir, pour des raisons diamétralement opposées à celles qui provoquent la colère de Vitruve, à des créations de nature irrationnelle et à la fantasmagorie délirante, comme contrepoids, serais-je tenté de dire, à son dessein de vérité et à sa volonté affirmée de mainmise sur la globalité du Réel. Autrement dit encore : il va se situer au point d’intersection et d’osmose des deux dimensions simples : la matérielle et la spirituelle, celle qui est finitude du corps et celle qui est infinitude de l’âme.
Ici, il me faut tenter d’expliciter le mot âya (pluriel : ayât(s)). Ce mot, qu’on traduit généralement en français par « verset », veut dire en fait, signe ou symbole, forme visible en quoi se trouve énoncé, je crois l’avoir déjà noté, un in-visible. Le visible n’est là que pour exprimer cet invisible qu’il recèle et qu’à la fois il révèle, le signe n’étant que le témoin d’un signifié. Ce signifié absorbe le signe et le dévore et c’est de transformer le signe en énergie que vivent signe et signifié dans une symbiose active qui les fait rayonner l’un et l’autre, l’un par l’autre. Une âya peut être naturelle, elle peut être intellectuelle, elle peut être linguistique, elle peut être sonore ou plastique : elle est la preuve monstrative plutôt que démonstrative de ce qu’il conviendrait d’appeler la Présence. Présence de l’Intemporel dans le temps, présence de la Transcendance dans l’espace ; présence de l’absolu du Verbe dans la langue. Un paysage de ce monde est une âya et, à vrai dire, c’est l’univers entier, témoin de la splendeur de Dieu, qui est un tissu indéfectible d’ayât(s) rayonnantes. Mais c’est le livre aussi, le Coran, qui est la parole d’Allah incarnée dans des signes – seule incarnation, d’ailleurs entièrement abstraite, que l’Islam veut bien consentir à reconnaître –, c’est donc le livre, dis-je, qui se trouve ainsi tissé d’ayât(s) « insurpassables » : cette insurpassabilité étant, au regard des Musulmans, la preuve de l’origine divine de la Parole communiquée par Allah à son Prophète « en langue arabe claire » (XXVI,195). La première parole adressée par l’Ange au pauvre homme, Muhammad, ployé sous une dictée, est : « Lis ! » (XCVI,1). Mais lui est un illettré, illettré majeur et duquel soudain on exige un déchiffrement :
Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! Il a créé l’homme d’un caillot de sang. Lis !… Car ton Seigneur le Très-Généreux Qui a instruit l’homme au moyen du calame Et lui a enseigné ce qu’il ignorait.
(XCVI, 1-5)
Parole déterminante : face au théâtre de la Création, qui est l’oeuvre de Dieu, face au théâtre de la communication qui est l’entreprise de Dieu vers l’homme par la médiation du calame, la pointe du roseau taillée en biseau qui est dorénavant l’achèvement de tout enseignement et le début de toute re-création. Il y a le cirque du devenir où l’homme, porteur à son tour du calame, de lui instruit et par lui motivé, va s’élancer – avec l’aide de Dieu – à la conquête de tous les possibles. Ainsi, dès le premier mot prononcé par l’Ange, l’univers de l’Islam est un univers à vocation sémiologique, entièrement fait d’ayât(s), de signes et de symboles. Comment un tel univers pourrait-il être traduit dans une langue : univers en puissance de dématérialisation, langue en prise d’univers ? Y aurait-il là l’effet d’une contradiction ? Le Coran la devance, et la dépasse. Il est le Dit de Dieu fait pour être lu : son nom même, Qur’ân, signifie Lecture ; il est la Lecture par excellence. Toute lecture est générative. Elle pourrait n’être qu’un épiphénomène – sauf s’il advient qu’elle soit remembrance : c’est-à-dire qu’elle soit, au-delà du signe verbal, épaisseur ontologique. Le Coran est lu et relu : il est la mémoire vivante, en progressive accumulation, du peuple de l’Islam. Mais d’être « incréé », le Coran s’allège de tout recours à la médiation de l’humaine voix et s’inverse (se reverse) dans une autre oralité. C’est cette oralité autre, cette scansion de l’informulable que l’Islam va tenter par la médiation de ses artistes, de ses artisans et de ses calligraphes, celle aussi de ses ornementalistes de toutes disciplines et en tous genres, celle aussi bien de ses miniaturistes, oui, c’est cette oralité-là où la voix semble vouloir se retirer dans sa source éternellement présente, c’est-à-dire éternellement absente et non dite, que l’Islam, par les mille calames et instruments variés qu’il a à sa disposition, va tenter d’inscrire ses signes dans un espace et dans une durée qui, eux-mêmes, n’existent que comme projections immédiates et médiates d’un absolu réservé. Réservé, comme ces “Tables réservées” sur lesquelles est inscrit le Coran de toujours. Quand je parle d’“oralité”, j’entends aussi bien évoquer le rythme visible que saisit le regard au sens où Paul Claudel, parlant de peinture, peut intituler son livre L’Œil écoute. D’être incréé, pour le Coran, spiritualise excessivement la langue spécifique dans laquelle il lui a bien fallu prendre corps afin d’être communiqué, peut-être même afin d’être pensé : puisque toute pensée, fût-elle pensée de Dieu, suppose et supporte une médiatisation. Le sacre de la langue arabe – sacre essentiel puisqu’il va être le point de départ de l’extraordinaire efflorescence de la calligraphie et de l’arabesque dans la totalité du décor islamique, ornementation, calligraphie, et tout l’ensemble du décor attesté, – est que cette langue est le support nécessairement physique du verbe divin ; d’où s’induira pour cette langue, et pour toutes ses projections dans le visible, un statut hautement privilégié, miroir de son élection nonpareille. Et c’est pourquoi l’art de l’Islam est un art de la lumière et pourquoi aussi il ne semble se refermer sur l’inscription de son être essentiel dans le visible que pour, à l’extrême pointe de ce refermement, interrompre la clôture annoncée par une ouverture, essentielle, elle aussi, qui relance la scansion du temps dans une figuration de – et vers – l’éternel. Art du vide et du plein, du plein dans le vide et du vide dans le plein, l’un étant le contrepoint de l’autre et son révélateur aussi bien – le vide n’étant qu’une occultation instantanée du plein et le plein qu’une condensation momentanée du vide – ce type d’art, saisi par la métaphysique, vise à produire le surgissement de la Présence par la mise en contact de deux propositions de sens inverse et leur élimination fulgurante l’une par l’autre. Haute civilisation du signe, du Monde/Langue et de la Langue/Monde, de la forme ouverte d’être fermée et fermée d’être ouverte, du vide/plein et du plein/ vide, l’Islam « tel qu’en lui-même » se trouve être, avec force et détermination, la civilisation du livre. C’est très souvent dans l’ornementation du livre que la splendeur signifiante s’exprimera avec le maximum d’intensité.
*
Ayant ainsi planté le décor spirituel de l’Islam en m’appliquant à identifier, à travers ses directives d’ensemble, quelques-uns de ses signes majeurs, je souhaiterai m’intéresser de plus près, les extrayant de leur tissu ontologique d’ensemble, à un certain nombre de ses signes et symboles. Ce sera inévitablement de ma part un regard limité à quelques formulations seulement. Pourquoi ces formulations plutôt que d’autres ? Parce qu’elles me paraissent les plus caractéristiques du répertoire inépuisable des thèmes et des motifs illustrés par la civilisation islamique et qu’aussi bien ces thèmes et ces motifs – qui se perpétuent jusqu’à nos jours en terre d’Islam – ont eu, dans l’Occident chrétien, aux époques romane et gothique, c’est-à-dire sur une période de huit siècles, une influence décisive. Il me semble donc particulièrement bienvenu d’observer les ornements suivants : l’Arbre de vie, le polygone étoilé, l’arabesque et son décor, la miniature et sa complicité avec l’enluminure, la structure en miroir. Détaillons un peu.
L’un des premiers signes qui méritent, ai-je dit, d’être observés est l’Arbre de Vie. Il est présent pratiquement depuis les origines dans toutes les mythologies, dans toutes les spiritualités, dans l’ensemble des systèmes symboliques sous toutes leurs formes. Il est omniprésent dans le décor de l’Islam qui est, pour l’essentiel, un décor végétal.
L’Islam, on l’a dit, est une “civilisation de la fraîcheur”.[4] Quand les polythéistes eurent jeté Abraham, le premier Musulman selon le Livre et le père fondateur de l’Islam, dans une fournaise spécialement aménagée à cet effet : « Nous dîmes (c’est Allah qui parle) : “O feu ! sois pour Abraham fraîcheur et paix » ». Et dans la mesure où l’Islam est une religion scripturaire, profondément attachée aux indications venues de l’ordre divin et par cet ordre tout le temps modelée et modulée, c’est à créer cette impression de paix et de fraîcheur que vont concourir, en convergence de finalité, toutes les expressions artistiques de son génie. Et quoi de plus frais, de plus vrai aussi, puisque l’art a pour dessein la vérité – fût-ce à travers l’évocation et l’appel à la poésie – que la fleur, que l’arbre, que la tresse et que l’arabesque feuillue, que l’eau et la représentation de l’eau, que la couleur unie contrastant avec d’autres couleurs unies en oppositions à la fois joyeuses et vives, que la nudité de l’espace préoccupé exclusivement de rythmer l’ombre méditative et la lumière filtrée, que le souvenir de l’élément liquide solidifié dans les alvéoles et les stalactites des muqarnâs, que l’accompagnement du texte manuscrit de lettrines et de guirlandes fleuries et, dans les exemplaires précieux du Coran, la séparation des versets par de petites rosaces d’or qui font de la page une prairie abstraite. Le décor d’une page (ou d’un tapis), outre l’Arbre de Vie, qui souvent est là stylisé, est envahi d’un semis de figures métamorphosées en gemmes, selon ce qu’en dira Louis Massignon dans son bref essai majeur sur « les méthodes de réalisation artistique des peuples de l’Islam », paru dans la revue Syria en 1921. Si l’interdiction de toute représentation de figure animée est la règle (l’orientaliste suisse Titus Burckhardt[5] parle de « l’aniconisme » de l’Islam), reste que certains sujets rencontrent moins d’opposition que d’autres : ceux où ne résident aucun esprit vivant, « arbres, fleurs et choses ». A partir de quoi une habile exégèse, se fondant sur certains hadîths, a étendu le champ de la représentation : pour placer dans une miniature, par exemple, et au milieu de cet espace en fleurs que généralement elle représente, l’image d’un être animé, il suffira – si l’on peut dire – de le « géométriser », de le mutiler ou de le rendre inidentifiable en lui ôtant tout caractère particulier, ne retenant de lui que le plus général, le privant de toute épaisseur, de manière à le rendre manifestement inapte à exprimer la vie dans sa tonalité vibrante et chaude. Retenons le propos du célèbre jurisconsulte Ibn-Abbâs en réponse à un miniaturiste qui l’interroge : « Mais quoi ? Ne pourrai-je plus peindre d’animaux ? Ne pourrai-je plus exercer mon métier ? » – « Que si », lui dit Ibn-Abbâs, « mais tu dois décapiter les animaux pour qu’ils n’aient plus l’air vivant et tâcher de faire qu’ils ressemblent à des fleurs ». Dans tous les arts musulmans, et même en poésie, il y a ce que Massignon a superbement baptisé « une descente de la métaphore ». C’est là un processus paradoxal dont l’objectif est d' »inanimer » l’animé : l’homme est comparé à tel ou tel animal, l’animal à une fleur, la fleur à une pierre précieuse : « Une tulipe est un rubis ». Quand, par exemple, le poète Imrou’el Quays qui est antérieur à l’Islam – mais l’imaginaire arabe est une continuité – évoque telle « fleur tachetée », c’est en fait la plaie sanglante d’une gazelle, tirée à l’arc qu’il entend décrire.
Passons maintenant à cette autre figure prédominante de l’art de l’Islam : le polygone étoilé. Comme son nom l’indique, ce type de polygone a pour référence l’étoile et l’on sait, comme pour l’Arbre de Vie, le rôle majeur joué par l’astre dans nos histoires, nos cultes et nos légendes. L’étoile à cinq branches est le symbole du microcosme humain ; l’étoile à six branches, avec ses deux triangles inversés, dit l’étreinte de l’esprit et de la matière, des principes actif et passif, le rythme de leur dynamisme, la loi de l’évolution et de l’involution. Unissant le carré et le triangle, l’étoile à sept branches participe du symbolisme du chiffre sept, chiffre prégnant, s’il en est, et, pour l’essentiel, elle exprime l’harmonie du monde et tout ce qui relève d’un rapport juste entre les choses, entre les êtres, entre les êtres et les choses, ou encore entre la terre et le ciel. Dans le domaine islamique, telle sourate du Coran est intitulée L’Etoile (LIII), telle autre l’Astre Nocturne (LXXXVI) et telle autre Les Constellations (LXXXV). Le polygone, comme d’ailleurs le polyèdre, dont l’ornementation architecturale de l’Islam fera grand usage, naît de la combinaison d’un carré et d’un cercle (ou d’une sphère), et des nombreuses formes qui peuvent dériver de cette combinaison initiale. Cette mise en relation de deux figures élémentaires fait du polygone étoilé ce qu’Ernst Diez a appelé un « art de la simultanéité »[6]. Jacques Berque y perçoit même, par « la virtuosité poussée jusqu’au sophisme »[7] , une dimension baroque introduite dans le géométrisme de l’espace du fait de la tension provoquée par ce mariage inattendu, tension maintenue, amplifiée même par la redondance et la récurrence du motif.
J’ai déjà à plusieurs reprises dans le cours de cette réflexion, évoqué l’arabesque, et j’y reviendrai encore en conclusion de cet exposé, quand je parlerai de la calligraphie. L’arabesque, comme son nom l’indique, est lié à ce qu’il y a de plus fondamental dans l’art et le décor arabo-islamiques. Elle est signe et symbole, abstraction, durée sans épaisseur s’inscrivant dans le temps sans temps, horizontalité porteuse de verticalité ontologique et, de ce fait, annulant l’espace qui lui sert d’appui et de support, ligne dénoncée à mesure qu’elle est énoncée et à nouveau s’énonçant à l’instant qu’elle semble s’effacer, calame de l’homme faisant réponse au calame d’Allah, lui aussi, lui surtout, inépuisable :
Si la mer est une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur la mer serait assurément tarie avant que ne tarissent les paroles de mon Seigneur même si nous apportions encore une quantité d’encre égale à la première.
(XVIII, 109)
L’arabesque, on le sait, vient de plus loin que l’art proprement arabe, qui pourtant lui aura donné son nom. Si l’arabesque à formes végétales, comme l’a noté Titus Burckhardt, semble dériver de l’image de la vigne « dont les rinceaux entrelacés – écrit-il – et les pampres enroulés se prêtent tout naturellement à une stylisation en formes ondulées et spiraloïdes », il n’en reste pas moins qu’avant d’être la projection sur une surface plane de l’Arbre de Vie », de la frise bacchique ou du chapiteau corinthien, elle existait déjà dans les arts de l’Asie centrale, dans « l’art zoomorphe » (Tierstil) des Scythes et des Sarmates et dans la double spirale du symbole chinois du yin-yang. Vagues de la mer ici, se déroulant l’une à la suite de l’autre, pourchas l’un de l’autre d’animaux identiques indéfiniment recommencés, pampres et vrilles helléniques et hellénistiques attendant d’être intégrées au symbolisme chrétien, l’arabesque va envahir, mêlée ou non à la calligraphie tout le décor de l’Islam, notamment en matière de l’illustration du livre. Intense dessèchement lyrique de telle écriture volontairement dépouillée, luxuriance fleurie de telle autre dont chaque lettre se fait hampe végétale, corolle déployée, plante épanouie. Souvent abstraite au début, l’arabesque se changera, selon le génie géométrique qui est souvent le sien, de références visuelles identifiables et, sinon la scripturaire qui est de par sa nature liée à la reproduction aussi lisible que possible des versets du Coran, de toutes sortes d’allusions aux modes de la vie, dans leur pouvoir de « cristallisation » algébrique ou logarithmique en quoi se retrouve cette notion de rythme si fondamentale à l’art de l’Islam. Il faudrait dire aussi que, du fait du retour progressif de l’Islam à sa pureté originelle sous la pression des rigoristes de plus en plus exigeants, l’arabesque, vers la fin de son développement millénaire, semble parfois, ici ou là, retrouver le chemin du dépouillement le plus sévère, au risque de voir se stériliser sa puissance inventive. Il faudrait enfin rappeler l’extraordinaire prégnance de cette projection décorative sur l’art médiéval européen, roman aussi bien que gothique, surtout gothique, et plus tard – malgré le retour de l’art gréco-romain et malgré l’intrusion de la perspective – dans l’art de la Renaissance. Pour ce qui est de l’art médiéval, je renvoie au beau livre de Jurgis Baltrusaitis, Le Moyen-Age fantastique : antiquités et exotismes dans l’art gothique[8] qui me paraît, en deux chapitres (II et IV), constituer un répertoire complet des thèmes, motifs ou figures empruntés par la chrétienté à l’art arabo-musulman.
« Dans le domaine du décor de la vie, l’Orient jouit d’un prestige légendaire », écrit notamment Baltrusaitis, citant pêle-mêle les clerici transmarini, l’enseignement du « sarrazinois », les traités d’astrologie arabe, ceux de médecine, de mathématiques ou d’optique, les grands philosophes arabes transmetteurs, entre autres, de l’antique philosophie grecque – sans compter tout ce qu’offre à l’Europe l’Andalousie si proche. Dans le domaine proprement ornemental, voici les frises du Psautier de Saint-Louis (1254-1270), celles de l’Apocalypse de Saint-Sever (1028-1072), voici les bandeaux portant les mots Mach’Allah, « ce qu’Allah veut », sur la porte de bois de la Voûte-Chilhac, voici les émaux de Limoges (vers 1225-1230) décorés de fleurs et de rosaces, voici les lettres gothiques ornées de fleurons et de palmettes à la manière des lettres coufiques, les entrelacs, les polygones étoilés et les carrés polylobés de l’Islam, les tondi, gruppi di cordi, gruppi mouschi, urabeschi ou cordelle alla damaschina qui fascinèrent jusqu’à Bramante (coupole de Sainte-Marie-des-Grâces de Milan), Léonard de Vinci (plafond de la Sala delle Asse du château Sforza) et Dürer qui les recopiera chez Léonard. Peut-être faut-il encore citer le caractère en demi-feuille rûmi si présent partout dans l’art gothique, les ornements à franges du Missel de Luçon (fin du XIXe siècle), ou ceux du Bréviaire de Belleville, par Jean Pucelle (1330-1340). Baltrusaitis parle en outre fort savamment des monstres hiératiques, des entrelacs vivants, du rûmi zoomorphique, des bêtes sans membres, des rinceaux à têtes et à troncs, du naskhi, style d’écriture anthropomorphe, du wakwak, d’autres thèmes fantastiques, et de ce fait profondément poétiques déjà surréalistes en quelque sorte, comme l’arbre du Soleil et de la Lune, l’arbre héraldique du Mal, l’arbre alchimique, l’arbre du conflit de l’âme . Dans le décor proprement épigraphique, de tels motifs inscrits en marge de l’illustration centrale sont l’oeuvre du mudhabbib ou doreur, à ne pas confondre avec le miniaturiste — comme l’art gothique, lui aussi, suivant en cela la tradition islamique, distinguera, du miniaturiste, l’enlumineur.
J’ai déjà évoqué l’art de la miniature qui accompagne de ses illustrations somptueuses tant d’évocations de textes sacrés et poétiques que des chefs-d’œuvre de la littérature arabe ou persane ou indienne du nord, le Voyage Nocturne de Mahomet et les Mille et Une Nuits d’une part ou l’épopée du Chah-Nâmeh d’autre part. J’ai dit quelques-unes des spécificités que cet art revêtait en Islam. Malgré son nom minimaliste, la miniature est un art majeur, avec une histoire, avec des variations et des influences, avec des styles. Certains historiens de l’art ont même été jusqu’à réduire à la miniature, art considéré par eux comme le plus représentatif, l’ensemble de la formulation plastique arabo-islamique. Quelle erreur, et quelle vue courte ! C’est – on ne le dira jamais assez – du jour où il acheta une miniature persane sur les quais de la Seine qu’Ingres deviendra Ingres (de même, d’ailleurs, qu’un siècle plus tard, c’est à contempler des tapis au soleil de Kairouan, en Tunisie, que Klee deviendra Klee). Du jour où il acquit cette œuvrette dans une échoppe du quai Malaquais, le maître du « Bain turc » allait découvrir ceci : que la ligne avait une existence autonome et que, porteuse d’un dynamisme propre, elle était féconde solitairement et, à la façon de l’arabesque – cette arabesque qu’aimera tant Matisse après lui – : elle pouvait n’être que rythme, c’est-à-dire le tout de l’art. Ce jour-là, pour Ingres et sa postérité, tout devenait possible – et les plus excessives déformations, les deux vertèbres ajoutées, par besoin de fluide et longue harmonie, à l’épine dorsale de l' »Odalisque », les saisissants télescopages de Picasso, le sein pointant du sommet de l’épaule…
La miniature arabo-islamique n’appartient donc pas seulement au domaine du sacré, loin de là. Cependant elle participe de l’ambiance générale de l’art islamique qui est, on le sait de reste, polarisé par l’abstraction. Alors que l’art occidental, notamment à partir de la Renaissance, va s’efforcer de donner une vision prétendument « objective » du monde, réalisme et perspective – mais ce « réalisme » n’est que dans l’œil du peintre et la « perspective » n’est que l’effet accidentel de sa propre position face aux choses : une convention « mentale » comme le souligne Léonard de Vinci –, le regard de l’artiste musulman sur le monde sera, délibérément et dès l’origine, un regard libre de toute sujétion à l’égard de quelque « réel » que ce soit. L’espace de la miniature est à deux dimensions et il est arbitrairement divisé ; la couleur y est pure et point modulée ; les objets et les êtres sont vus et définis non selon des signes distinctifs, mais en leur qualité de représentants anonymes d’une catégorie existentielle. Ce qui est vrai des personnages des Mille et Une Nuits l’est aussi des personnages – des miniatures. De ces personnages, littéraires ou picturaux, j’ai écrit dans mon livre Archer aveugle[9] : «[…] Ce sont autant de figures d’un jeu d’échecs, figures emblématiques, que l’on verra manoeuvrer dans le cadre du récit, qu’il fût fragment des Mille et Une Nuits, maqamât de Harini ou de Badi ez-Zamâne el-Hamazâni, ou même, puisque leur ensemble fut récupéré par l’imaginaire arabe qui s’y plut à s’y reconnaître, fables du Baïdaba (Pilpay). Figures symboliques et comme interchangeables, à la manière de celles qu’on voit délicieusement peintes dans les miniatures persanes et turques où chacun, le faste plus ou moins grand du costume mis à part, ressemble, dans sa tranche d’âge, à chacun. Ainsi l’espace islamique est-il, comme le temps islamique, une catégorie immuable où jouent seulement, au regard de l’attention, d’exquises variations pareilles à ces précipitations qui courent, en musique, à la périphérie du thème.
Une représentation figurée particulièrement inattendue est celle qui concerne l’arbre à têtes, dérivé de l’Arbre de Vie : entrelacs, tresses, frises, arabesques, rinceaux, tissus, vont se peupler d’éléments zoomorphiques ou anthropomorphiques. Certes, ce sont toujours des créatures rendues fantasques ou fantasmatiques, c’est-à-dire inaptes à la vie, par le style même de leur figuration : forme semi-animales, semi-végétales entremêlées, bêtes sans pattes, bustes humains greffés sur des lettres en demi-feuilles, écriture naskhi (à savoir cursive) apprivoisant un vrai bestiaire onirique.
Voici l’Arbre de Vie transformé en arbre de la Mort, en arbre de l’Enfer. L’animal, l’homme du Mal lui-même vont trouver une vélocité nouvelle et une alacrité saisissante dans ce théâtre de la dérision : « L’animal n’est pas anéanti par l’abstraction. – écrit Baltrusaitis – Tout au contraire, les angles et les courbes semblent l’inciter à la mobilité. Aussi la bête ne tardera-t-elle pas à s’évader de ces méandres réguliers et à défaire la tresse où elle est née ». Et plus loin : « Les têtes les plus diverses s’attachent aux tiges : têtes barbues, cornues, à longues oreilles de lièvre, têtes d’âne, de renard, de chien, de bœuf, têtes de serpents ou de poisson, têtes d’hommes. fixées sur les rameaux flexibles, elles s’y balancent comme d’énormes fruits. Il suffit bien d’une plante, monstrueusement épanouie et non d’un animal-rinceau ou demi-feuille […] Les bourgeons explosent sur toutes les branches. Les gueules se multiplient, se pressent en cohue. Sur le plumier de la collection Marquet de Vasselot, on en compte vingt, par groupe de deux rinceaux, et sur le bassin d’un sultan ayyoubide (1249), une rosace polylobée en comporte à elle seule vingt-six. Depuis longtemps, floraison aussi sauvage ne s’était vue.» Parmi les animaux ou les plantes fantastiques, il y a, qui auront, eux aussi, une postérité considérable dans l’imaginaire occidental, les animaux et les motifs floraux « affrontés », accouplés dans la symétrie et placés, pour l’éternité, en miroir. Surréalisme, donc, avant la lettre.
L’Islam est de fait une civilisation du miroir : miroir l’algèbre, miroir la géométrie, miroir les indéfinies, les infinies récurrences de l’art islamique dans la diversité de ses inspirations et de ses techniques. Quoi de plus matérialisant et quoi de plus dématérialisant que le miroir qui ne recueille le donné du réel que pour, ce réel, réduit à l’apparence, le rendre plus illusoire encore ? Le monde est le reflet de Dieu, disent les textes de tous les grands maîtres soufis. Je ne retiendrai qu’un seul témoignage de ce type de vision, c’est un étonnant apologue de Djelâl-Eddine Roumî tiré du Mathnavî qui, mieux que toute analyse, parvient à formuler l’essentiel de ce qui fait la lumière et le mystère de l’art islamique, art qui, derrière le voile de la forme abstraite ou semi-figurée, attend tout de la lumière d’en-haut ou de celle d’en face : « Un jour, un sultan appela à son palais des peintres, venus les uns de la Chine, les autres de Byzance. Les Chinois prétendaient être les meilleurs des artistes ; les Grecs, de leur côté, revendiquaient la précellence de leur état. Le Sultan les chargea de décorer à fresque deux murs qui se faisaient face. Un rideau séparait les deux groupes de concurrents qui peignaient chacun une paroi sans savoir ce que faisaient leurs rivaux. Mais, tandis que les Chinois employaient toutes sortes de peintures et déployaient de grands efforts, les Grecs se contentaient de polir et lisser sans relâche leur mur. Lorsque le rideau fut tiré, l’on put admirer les magnifiques fresques des peintres chinois se reflétant dans le mur opposé qui brillait comme un miroir. Or, tout ce que le Sultan avait vu dans le mur des Chinois semblait beaucoup plus beau, reflété sur celui de Grecs ».
*
Concluons.
J’ai évoqué quelques-uns des signes de l’Islam, dans leur projection dans l’art – art interne à l’Islam, art externe – et je me dis à nouveau et pour me résumer, que celui-ci est, au-delà de toute cette substance et à travers bien des paradoxes, la civilisation du signe.
La calligraphie arabe, très particulièrement, l’une des plus déterminantes, artistiquement parlant, dans le décor de la vie et du livre, se trouve être le témoin privilégié du surgissement de l’esprit et de son accession à l’immanence. La sérénité de la main, et son élégance, traduisent à leur façon la pesanteur et la légèreté des permanences. Le retour du signe sur lui-même, autrement dit son élaboration qui, parfois, se complique harmoniquement jusqu’à l’illisibilité – illisibilité du premier niveau mais lisibilité majeure au second et au troisième niveau, celui de la préhension par le rapt d’aigle du regard tourné vers le dedans – cette élaboration complexe et compliquée exprime assez, par l’annulation obtenue de la figure immédiate, la majesté de l’intemporel. Et lorsque vers la fin de la grande période classique le calligraphe s’adonne quelquefois à l’art de mimer savamment par l’écriture le signe épiphanique de l’objet ou du concept évoqués, il cède à une tentation de nature nominaliste, assez présente dans le déploiement des stratégies philosophiques de l’Islam où la chose désignée et le nom désignant tendent à se confondre. Une dernière observation à ce sujet, pour énoncer qu’il n’est rien de plus contraire à l’esprit du calligraphe islamique que celui du calligraphe zen, lui aussi agent et témoin d’une tradition spirituelle de haute volée : là où le musulman veut signifier, par le tour et le détour de la ligne, la patience de l’éternité, le mystique japonais, aujourd’hui très en faveur auprès des amateurs d’art, veut, comme par le geste bref du voleur de feu – brusque déchirement du tissu invisible au profit d’une parousie du mental – dire l’intuition d’un instant radical en qui se résument et se résolvent les contradictions dramatiques de l’Être, et le geste lui-même du calligraphe participe à cette dramatisation. J’affirme, en revanche, que la main du calligraphe musulman est médiatrice d’un calme en infinitude.
Ce même calme, cette même infinitude, règlent le rituel mille fois semblable à lui-même de l’arabesque, reprise de la vague par la vague pour exprimer symboliquement en surface la profondeur incommensurable de l’Océan : « Tant de sommeil sous un voile de flamme », écrit, dans un autre contexte, Paul Valéry. J’ai moi-même noté dans mon ouvrage La Unième Nuit[10], que l’arabesque, interruption interrompue, rupture indéfiniment réunifiante, était l’une des clés modulatrices de l’imaginaire islamique, à la manière, pourrait-on penser, des Mille et Une Nuits, récit dans le récit, mise en abîme d’un réel qui, d’être ainsi réfléchi de miroir en miroir, devient mythique. Le peu de réalité, c’est la réalité frappée de nullité par la nostalgie dévorante de l’Être. Revenant à l’arabesque, je dirai que l’une des inventions les plus saisissantes de la créativité plastique de l’Islam aura été l’intégration l’une dans l’autre de l’arabesque et de la calligraphie, magnifiquement complémentaires et convergentes dans leur vœu d’unité.
Cette même convergence, cette même cohérence des signes, c’est cela qui distingue une culture et qui en constitue, face à d’autres convergences, à d’autres cohérences, la spécificité. Certes, il n’y a pas lieu de s’appesantir sur la correspondance des signes entre les civilisations et les cultures comme sur autant de feux qui se répondraient d’un rivage à l’autre et, pourquoi pas ? d’un monde à l’autre : énoncé approximatif pour exprimer la division seulement d’apparence là où n’existent qu’une continuité, qu’une instantanéité ontologiques. Et l’instant, en Islam, n’est pas l’instant : il est, aussi bien, le Tout. L’image, aussi bien, n’est pas l’image, l’ornement n’est pas l’ornement : ils sont, par la médiation de toute création « imaginaire », le point de fulguration de l’inimaginable et de l’inimaginé ou, mieux, de l’inimagé. Il reste que, civilisation négatrice et négatrice doublement pour une meilleure affirmation par la shahâda, par le lâ illah illa’ Llâh, de la pérennité du Seul Perdurable, l’Islam – qui inventa entre autres l’algèbre – n’a à sa disposition, pour communiquer et pour se communiquer, que le dessèchement admirablement fertile de ses signes déployés à tous nos horizons essentiels.
Salah Stétié
[1] Traduction due à Denise Masson, la Pléiade, Gallimard. [2] Traduction d’Armel Guerne. [3] Charles Baudelaire : Fusées. [4] La formule est de Gabriel Bounoure. [5] Cf. son remarquable ouvrage : L’art de l’Islam, langage et signification, paru aux Editions Sindbad en 1985 [6] Ernst Diez, Simultneity in Islamic art, Art Islamica, tome IV, 1937. [7] Jacques Berque, De l’Euphrate à l’Atlas, tome 2 : Histoire et nature », Sindbad, 1978. [8] Armand Colin, édit. [9] Salah Stétié : Archer aveugle, Fata Morgana, 1985. [10] Salah Stétié, La Unième Nuit, Stock, 1980, repris dans En un lieu de brûlure, anthologie d’œuvres de l’auteur, paru dans la collection « Bouquins », Robert Laffont, 2009.