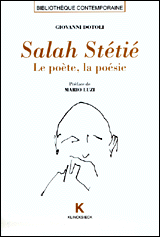UNE LETTRE DE TROP
par Alexis Nouss,
Université de Montréal
(Prononcé lors de l’hommage à Salah Stétié,
au Sénat, à Paris, le 26 septembre 2003)
Un poète fiancé écrit : « Bientôt la fin. […]//Les uns et puis les autres. Il n’y aura/Personne pour nous toucher. Et si les linges s’usent/Ce sera par des nœuds faits et défaits/Sans nous, sous le vent couvert de pierres//Et qui dira les mots sera ce jour l’aimant/Pour attirer le corps du feu. Et qui/ne dira rien sera habillé par les mots/D’un autre, dits pour le sauver » (Fiançailles, p. 27)
Un méditant écrit : « Il n’y a pas d‘homme (ni de femme) qui n’ait eu à un moment donné – ne fût-ce que pour une fraction de seconde – tout pouvoir sur la vie d’un autre. Mais l’homme doit être meilleur qu’on ne le croit, ou plus timoré. Bien des croix sont ainsi restées inoccupées. » (Carnets, p.191)
Un philosophe écrit : » La substitution à l’autre est comme la trace de l’exil et de la déportation « .
Le philosophe : Emmanuel Lévinas, que je cite encore une fois en lisant Salah Stétié, que je convoque encore une fois en commentant ses deux dernières parutions, Fiançailles de la fraîcheur et Carnets du méditant .
Lévinas, une nouvelle fois. Parce que l’écriture de Salah Stétié relève du sémitisme, de même qu’en participe la pensée de Lévinas sur le plan philosophique. Le mot est très laid, je l’avoue : sémitisme. À moins d’y entendre : idéologie de ceux qui croient encore en la vertu de semer .
Quoi qu’il en soit, j’ai besoin d’un terme pour désigner un horizon éthique et herméneutique particulier, qu’il nous faut reconnaître et explorer, qu’il nous faut surtout ne pas abandonner aux revendications identitaires et communautaires. Auquel il nous faut faire voix dans un horizon plus général, celui de la culture occidentale. Il est urgent et impératif, aujourd’hui de le tenter, en regard du difficile et exaltant devenir européen, en regard des relations internationales telles qu’elles se nouent dans le tragique et l’absurde au Proche-Orient. Paradoxe, car ce sémitisme trouve son habitat dans le désert, dans le non-limité, dans le tranchant du jour qui s’abandonnerait au velours de la nuit ; il refuse d’être un modèle, comme il récuse tous les maîtres. Sauf le plus grand, qui est si grand qu’il n’existe pas.
Mais paradoxe à tenir car, précisément, ce que le sémitisme veut montrer à l’Occident, c’est que l’Occident en est capable. Que l’Occident peut aussi être errant, nomade, prophète. Qu’il peut décliner son orient sur les modes fraternellement divergents d’un Rimbaud et d’un Saint-John Perse, d’un Mallarmé et d’un Lautréamont. Bref, que le feu qu’il est susceptible de voler n’est pas seulement celui de la puissance, qui est toujours la puissance de tuer, mais celui, non moins, de la « matière du cristal », titre du poème qui dit : « Je marche dans la ville, j’avance/Entre les deux orients, les occidents/Vers un lieu de prière […] » (Fiançailles, p. 154)
Lieu de prière, de rêve ou de folie. Point de ralliement de certains « voleurs de feu » qui firent leur chemin jusqu’au cœur d’un ministre, ami du poète-méditant qui écrivit lui-même Les porteurs de feu. Poète-méditant avec un trait d’union car méditant ne vient pas adjectiver poète. Poète et méditant sont deux métiers deux fonctions assumées parallèlement.
Emmanuel Lévinas, dans un cours de janvier 1976, développait son éthique radicale, celle qui soumet la liberté du sujet à sa responsabilité, qui affirme que le sujet devient sujet en se mettant non au service de son ego, de son soi-même, mais au service de l’autre, radicalement, c’est-à-dire à la racine de son être ; être d’abord pour l’autre avant d’être pour moi, et ce faisant, devenant moi. Il précisait donc : « Dans cette reponsabilité, le moi ne se pose pas mais perd sa place, se déporte ou se trouve déporté. La substitution à l’autre est comme la trace de l’exil et de la déportation » .
Exil et déportation : les mots sont lourds et Lévinas ne se cache pas derrière quelque futile pudeur. Les mots sont lourds du poids de l’histoire et c’est précisément ce poids qui les légitime. S’ils ont parfois du mal à appartenir à une terre, les peuples sémites, les peuples du livre – et disant cela, je n’entends pas traduire pas le latin biblia mais davantage, au plus près de l’étymologie, Torah, qui veut dire enseignement, et Coran, qui veut dire lecture, les « écritures de l’orgueil » comme le dit Salah Stétié (Carnets, p. 50) – les peuples du livre sont familiers de l’exil et de la déportation. Je n’ajoute pas « hélas ». Car de ces phénomènes, les peuples sémites ont fait un savoir et une sensibilité, ce qu’on appellera le sémitisme : la connaissance par le désert et par l’errance, de même que Michaux préconisait la connaissance par les gouffres.
« Poésie, terre d’exil » s’intitulait le colloque tenu à l’Université de Montréal en octobre 2002 et consacré à Salah Stétié. À cette occasion, Salah Basalamah produisit une calligraphie pouvant se lire, génie de l’écriture arabe, « Poésie, terre d’exil » ou « Exil, terre de poésie ». Le signifiant « exil » nomadise ainsi entre une acception abstraite et sa signification contrète. Mais de même qu’il reçoit une charge symbolique, il convient d’accorder à « déportation » la même possibilité. La déportation, dans l’énoncé lévinassien, doit se comprendre comme la rencontre de ou avec l’altérité. Rencontre, ici, signifie tremblement, ébranlement, convulsion volcanique, raz de marée, ce qui déracine l’être, le déporte hors de lui-même.
Pour provoquer un tel mouvement, l’altérité doit se comprendre dans son sens plein, qui est son unique sens, qui est un sens inassignable. En vérité, je ne peux jamais connaître ou reconnaître l’altérité. Si je puis dire : « ceci est autre », je le fais en rabattant le phénomène sur une grille d’intellection, je le ramène à du connu, à ce qui me permet de dire : « ceci est autre », c’est-à-dire que je le défais de son altérité, qui relève du strictement inconnu et inconnaissable.
En dernier regard, seules deux instances relèvent de l’altérité : Dieu et la mort. Dieu qui, pour être Dieu, ne peut être cerné dans un quelconque cadre humain et la mort dont je ne saurai jamais rien (aporie connue : ma conscience de vivant m’empêche d’expérimenter ce qui est en dehors du vivant et, en retour, la mort est la fin de ma conscience). La poésie, à partir de la finitude humaine, s’investit du pouvoir d’ouvrir une brèche dans le non-savoir vers le ressenti extatique auquel appelent ces deux exemples.
S’ouvre cependant une troisième direction, à en suivre Lévinas qui avance : « L’amour n’est possible que par l’infini mis en moi, par le plus qui dévaste et éveille le moins, détourant la téléologie, détruisant l’heur et le bonheur de la fin. » (Dieu, la mort et le temps, p. 256) Salah Stétié le suggère pareillement qui interroge d’un même souffle la mort et l’amour (et le divin également, en une mesure discrète qu’il faudrait scruter en une autre étude).
La figure de l’amour, affection et érotisme, dans une interrogation poétique sur la mort. Scandaleux, oui au sens où le scandale de la mort se résoud, se dissipe ou se confond dans le scandale de l’amour. Provocation qui jaillit dès le titre : Fiançailles de la fraîcheur. Salah Stétié nous berne et s’en amuse. Il nous a habitué au trompe-l’œil, au jeu des miroirs, à la danse des réfractions. Mais là, le poète est maître es-illusions. Car ce qui dissimule derrière le doux frémir de ce syntagme, tout en fricatives et en sifflantes, est grave.Il ne s’agit pas du couplet connu sur eros et thanatos entrelacés, pas le désir et le désert, pas « la mort est plus fort que l’amour » ou vice-versa, puisque les deux se disent. Le propos, en ces pages, s’élève à l’exigence ontologique.
Une section de Fiançailles de la fraîcheur est précisément, audacieusement, intitulée « La mort ». Le lecteur peut en redouter la teneur. Un poète est absent et il écrit. Et il l’écrit. Seuls les poètes le peuvent. Romanciers ou dramaturges en sont incapables. Seuls les poètes, mais peu l’osent. L’exercice est dificile et dangereux. Il faut écrire son absence sans être absent à son écriture. Les élévations sont généralement déconseillées aux personnes souffrant de vertige. Ici, le vertige est faculté requise et indispensable. Chaque poème, chaque vers, chaque mot ne sont que suspensions de vertige, pauses que s’accorde un pas qui défaille, reprises de souffle, selon l’expression de Paul Celan, Atemwende, titre d’un de ses recueils.
Ne pas s’y tromper. Cette fraîcheur, si elle est ennivrante, n’est pas réconfortante. Elle n’offre pas refuge au promeneur frappé de chaleur, elle ne console pas, ne repose pas. Elle peut faire grelotter. Ce n’est pas l’ombre généreuse, maternelle du feuillage au midi de la plaine mais l’obscur qui s’abat sur le pélerin lorsqu’il pénètre dans la cathédrale. La couche d’accablement au bout du chemin, à l’entrée de la nuit, pour le voyageur harassé.
Il faut beaucoup aimer Salah Stétié pour accepter ce recueil, accepter qu’il l’ait écrit. Accepter d’entrer avec lui en cette fraîcheur alarmante, celle d’une tristesse sereine. Il demande au lecteur d’abandonner toute attente d’un apitoiement lyrique. Dans l’ »Art poétique » qui ouvre le volume, le poète nous avertit : « Les signes sont durs « , « évasifs et coupants comme le fil d’un couteau » (Fiançailles, p. X). Sa parole tient parole. Elle nous blesse. Il y est trop question de mort, de départ, de mélancolie, de solitude.
Sa parole nous blesse. Sans souffrance, toutefois. Car elle nous inspire, et nous enseigne. Rassurez-vous, le verbe de Salah Stétié n’a pas changé, il est toujours tournoyant, hésitant, inquiétant, bref, rassurez-vous, il n’est pas devenu rassurant. Il enseigne mais il ne pontifie pas, ne dogmatise pas, ne professe pas.
Car un poète ne saurait le faire. Pas de métaphysique. Lorsque le méditant parle de la mort – il le fait souvent dans ses carnets -, il ne s’éloigne pas du métier poétique : « La mort, dit-il, est l’autre nom de la mort – qui n’a pas de nom. Quel nom, pour l’innommable ? Et pourtant il faut apprendre à l’épeler. Et à le retenir, ce nom, par cœur. Tant que le cœur est là. » (Carnets, p. 73)
En lisant ce fragment, je me suis arrêté sur le mot « épeler ». Pourquoi ce verbe ? Pourquoi devoir épeler le nom « mort », et non pas le prononcer ? Pourquoi insister sur l’orthographe ?
Il m’est apparu que cet énoncé vient peut-être éclairer une maxime qui le précède immédiatement : « La mort est un mot de trop qui, un jour, nous sera adressé, par hasard. » (Carnets, p. 71) Un mot de trop ? Or, mon attention attirée sur la dignité de l’orthographe suggère cette variation : « La mort, c’est une lettre de trop qui vient s’ajouter, par hasard, à un autre nom : mot. »
Que nous enseigne, alors, cette lettre ? De quoi parlent, par exemple, les huit poèmes composant la section intitulée « La mort » ? — D’amour. Autre jeu de mots, ou de lettres.
Salah Stétié écrit : « Ô mon amour le dernier mot &Mac253;s’éteindre&Mac253;/Est dans la rue en flamboiement de flamme/l’amour l’accueille et l’aime:/Il est le pigeon de son cœur » (Fiançailles, p. 68). Le poète, parlant de la mort, nous parle de genèse. « Fillette avant l’amour devenue femme », le vers se répète à plusieurs reprises. Et le poème inaugural dit : « Le blé de seigneurie/[…]Dans l’air brillant éclairé de pavots/Au seuil de la beauté des morts/[…]Libres lumières errantes des pavots… » (Fiançailles, p. 67) Pavot : non plus symbole de sommeil mais, comme chez Celan, symbole d’éveil.
Le poète sait que la nature s’y connaît en matière de mort. Il y est attentif, nous livre aussi dans le même recueil une « Méditation sur la mort d’une figue ». Il faut la lire avec, en regard, les photographies de Jacques Clauzel, en noir et blanc. Comme l’écriture de Salah Stétié, voudrais-je dire. Que signifie cette proposition ? A-t-elle même du sens ? Une écriture n’est-elle pas toujours en noir et blanc ? Le noir de l’encre sur le blanc de la page, pour l’écrivain comme pour le lecteur. Et qu’une encre puisse être verte ou violette n’y change rien : « La mélancolie d’une encre/Dresse d’insectes/Un lieu mal établi et peu solide » (Fiançailles, p. 28) ; « L’écriture porte le deuil du monde. L’encre est noire. » (Carnets, p. 167)
Écrire serait précisément mettre du noir sur du blanc, de la noirceur sur l’immaculé, la nuit dans le jour : « Quelle nuit/En ce jardin/Devenu de substance à fleurs tragiques ? » (Fiançailles, p. 70). Attention, toutefois : mettre du noir sur du blanc n’est pas mettre quelque chose « noir sur blanc », selon l’expression courante. Celle-ci vise la fixation, l’immobilisme, la fondation, le contrat. Au contraire, le noir sur le blanc produit un telle violence que la conséquence en est le déséquilibre, le vertige. Le noir sur le blanc : une plaie ouverte. Sanglante. Rouge sang, ou rouge feu.
Car le noir et blanc ne s’oppose pas à la couleur dans l’écriture, pas plus que dans le rêve. On ne rêve jamais en couleurs, toujours en noir et blanc. Et pourtant, au sortir d’un rêve, qui dira qu’il n’a pas rêvé en couleurs, qu’il ne se souvient pas des couleurs de son rêve ? Le noir et blanc de Salah Stétié est analogue au noir et blanc du rêve, qui porte les couleurs, qui les traduit, qui de la séduction des couleurs refuse l’apaisement pour en retenir la vibration et l’ivresse. Noir et blanc des pierres d’une chapelle recueillant le chatoiement des vitraux, le retenant.
Il faut lire le noir et blanc de Salah Stétié. Il faut le lire dans un monde qui refuser d’admirer « les grands béliers sauvages » (Fiançailles, p. 131) et préfère les cendres grises de la dévastation. Le lire pour se tenir debout. Le poème intitulé « Fiançailles de la fraîcheur » se conclut : « Le livre est écrit, achevé, l’ange a replié la montagne/Et seulement dans le jour finissant un homme/Debout dans la fluidité des arbres » (Fiançailles, p. 122).
Lire Salah Stétié, c’est obliger le monde à retrouver sa fraîcheur. La première section de Fiançailles de la fraîcheur s’intitule « Seize paroles voilées ». Le plus fort de l’amour se joue lorsque le fiancé s’apprête à relever le voile qui dissimule le visage de sa fiancée. La parole de Salah Stétié nous apprend l’exaltation d’un tel geste dans la pudeur et l’impatience, la fierté et la crainte. Quel que soit le visage de la fiancée.
Alexis Nouss,
Université de Montréal